
Dans les années soixante, au chemin du Laquay, dans le quartier dit « des Italiens » PHOTO D.R. – Collection Nicole d’ALATRI
La scène se passe le 14 mars 1763, un lundi. En ce règne du roi Louis XV, Barthélémy Quenin, un paysan aisé du quartier du Moulin-à-Vent, se rend devant le notaire de Vénissieux en compagnie d’un maçon, maître François Peret. Tous deux viennent pour passer un « bail à prix-fait », autrement dit un contrat de construction. Moyennant 500 Livres, une somme équivalente à trois à cinq ans de salaire d’un ouvrier agricole, maître Peret bâtira pour Quenin une jolie maison en pisé, dûment pourvue de portes et de fenêtres en pierres de taille de Couzon-au-Mont-d’Or. Le chantier durera à peine quatre mois et sera réglé en trois paiements étalés sur deux ans. Puis, l’affaire étant conclue, le client déclare ne point savoir signer, tandis que le maître maçon signe en toutes lettres son prénom et son nom : « Francesco Perello ». Coquin de notaire, il les avait francisés ! En fait de Vénissian, maître Perello nous arrive tout droit du Piémont, alors un royaume indépendant en Italie, ayant Turin pour capitale. Le Piémont est à cette époque particulièrement réputé pour ses maçons, notamment la Valsesia, entre le Val d’Aoste et le lac Majeur, au point d’en expédier en quantité au-delà des Alpes. Ce sont ainsi des Piémontais qui, entre 1590 et 1620, construisent la toute nouvelle enceinte fortifiée de Grenoble. Chez nous, Francesco Perello multiplie les chantiers pendant plusieurs années, et devient le premier Italien connu à résider à Vénissieux.
Le premier, mais non le dernier, et loin de là. À partir du milieu du XIXe siècle, le quartier de Saint-Fons, faisant alors partie de la commune de Vénissieux, se couvre d’usines chimiques, dont celle de Claude Perret. Les besoins de main-d’œuvre de ces entreprises sont tels qu’elles recrutent largement dans notre région, mais aussi jusqu’en Italie. La preuve : en 1871, l’on assiste au mariage à Vénissieux de Giuseppe Bovo, « employé d’usine » à Saint-Fons, venu du village de Manta ; en 1871 toujours, à celui de Vincenzo Bianco, « ouvrier d’usine » à Saint-Fons, né à Camagna ; en 1874, à celui de Tommaso Suppo, « manœuvre », né à Almese. Et ainsi de suite, sur des pages et des pages des registres d’état-civil. Tous sont italiens, et tous, sauf exception, proviennent du Piémont, et notamment des provinces de Coni, de Biella, d’Alessandria ou de Turin. Ils ont quitté la Botte car les maigres terres de leurs parents agriculteurs ne les nourrissaient pas assez, et ont souvent suivi qui un frère, qui un cousin ou un voisin, qui les a précédés dans la migration en région lyonnaise. Arrivés chez nous à la vingtaine passée de peu, ils se sont intégrés petit à petit, se sont mariés avec une compatriote ou, bien souvent, avec une jeune femme venue du nord-Isère voire avec une Vénissiane, et ont eu des enfants : comme Giuseppe Durbiano et sa femme Marie Bart, dont les petits Jean, Marguerite, Augustin et Baptiste, sont âgés en 1886 de 9 ans à 4 mois.
Résultat de ces arrivées et de ces heureux évènements, la communauté d’origine italienne voit ses rangs grossir de plus en plus à Vénissieux, au point qu’en 1886, le recensement liste 63 foyers transalpins, totalisant 244 personnes. Soit 4 % des 5 884 habitants que compte alors la commune. Ces migrants d’antan ne roulent pas sur l’or. Bon nombre d’entre eux sont illettrés et, quand vient l’heure de se marier, ils n’ont souvent pour tous biens que leurs vêtements sur le dos. Ainsi en 1871, le notaire recevant le contrat de mariage de Vincenzo Bianco précise que « l’avoir actuel du futur époux ne consiste qu’en son vestiaire, qu’il n’estime pas ». Seul Pietro Biola, originaire de la province de Novare, vole un peu plus haut, puisqu’il déclare en 1875 que « son avoir actuel consiste en divers immeubles sis à Strone (Italie), d’une valeur de cinq mille francs ». Il faut dire que ces Italiens, comme bien d’autres migrants en bien d’autres époques, occupent les emplois les plus durs et les plus mal payés. Sont-ils pour autant bien vus par les Français qui les entourent ? Non. Les mariages entre Vénissianes de souche et migrants d’outre-monts, et la francisation systématique de leurs prénoms voire de leurs noms, n’empêchent pas une xénophobie latente et de nombreux conflits. Comme cette « rixe sanglante [qui] s’est produite avant-hier à Saint-Fons entre ouvriers français et italiens », raconte le journal La Tribune du 11 mars 1887. Et le journaliste de déballer un discours que l’on entendra pendant encore longtemps : « On sait que les ouvriers français reprochent aux ouvriers piémontais de travailler à des prix peu rémunérateurs, et pour cette raison on donne la préférence à ces derniers, qui en ce moment sont tous occupés, alors qu’un grand nombre d’ouvriers français chôment ». Conclusion, les patrons soucieux de patriotisme devraient se débarrasser de cette main-d’œuvre étrangère, d’autant que « l’ouvrier italien, gagnant peu, travaille de même »…
Cette xénophobie, qui culmina en 1894 après l’assassinat à Lyon du président Sadi Carnot par un anarchiste italien, n’arrêta pas le courant migratoire transalpin en direction de la région lyonnaise en général, et de Vénissieux en particulier. Bien au contraire, la saignée de 1914-18 et la nécessité de relancer l’économie provoquent entre les deux guerres mondiales un nouvel appel de main-d’œuvre, venue du Piémont toujours, mais aussi de la province de Frosinone, à mi-chemin entre Rome et Naples. Comme avec Benoît Gazzellone, né à Roccasecca en 1894, et qui se marie le 13 janvier 1923 avec Claudia Combet, une habitante de la rue de La Borelle. Résultat, en 1926, les Italiens constituent 9 % de la population vénissiane, avec 1 050 personnes. Le Vénissieux multiculturel était né.
Sources : Archives du Rhône, 3 E 11453-11454, 3 E 11 577 à 11 589, 4 E 5388, 4 E 6132, 4 E 14283-14284, 6 M 368. P. Videlier, « Les Italiens de la région lyonnaise » (Persée, 1986).

PHOTO D.R. – Collection Nicole d’ALATRI

















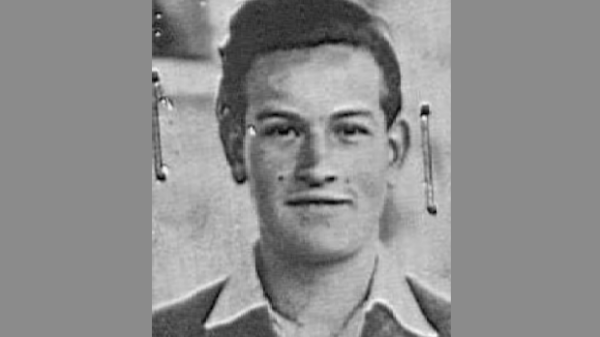



















Derniers commentaires