
Photo Emmanuel FOUDROT
Michel Sportisse a de qui tenir. Ce Vénissian qui habite au Laquay depuis 1977 a un oncle résistant, Lucien, qui a participé à la naissance du Parti communiste algérien et fut assassiné par la Gestapo en 1944, à Lyon. Et un père, William, qui fut militant et journaliste. C’est en cette qualité que ce dernier fut envoyé en Hongrie, entre 1954 et fin 1955, pour envoyer des informations dans toute l’Afrique du nord pour le journal La Voix de l’indépendance. D’où la naissance à Budapest de Michel.
« Suite à des pressions, mon père a dû quitter la Hongrie. Nous sommes retournés en Algérie et il est devenu le responsable communiste de la région de Constantine. Il a aujourd’hui le statut de moudjahid, c’est-à-dire d’ancien combattant. »
Michel Sportisse se présente ainsi : « Je viens d’une vieille famille juive, implantée en Algérie depuis longtemps. Ma grand-mère berbère ne parlait qu’en arabe et en tamazigh. Elle a appris la langue française pour savoir ce que disaient de son fils les journaux français. Ma mère était italienne et son père était déjà né en Algérie, en 1887. Mon arrière-grand-père était originaire du sud de Naples, sur la côte amalfitaine. Je suis né dans un milieu qui n’était pas acquis aux idées colonialistes. »
Les souvenirs affluent et voici que remonte à la mémoire de Michel une manifestation qui s’est déroulée à Philippeville le 13 décembre 1960. « Il y avait énormément de femmes et d’enfants, le peuple algérien était dans la rue et montrait son courage. J’avais six ans et j’ai été marqué par l’événement, alors qu’on n’entendait partout que les discours des partisans de l’Algérie française. Pourtant, même au lendemain de l’Indépendance, le FNL n’a pas voulu parler de cette manifestation. »
« Sortir de mon milieu d’origine pour comprendre ce qui se passe ailleurs fait partie de ma nature. »
Autre souvenir : celui d’un voyage à Moscou, en 1964, alors qu’il a dix ans et est membre des Jeunesses communistes. « J’ai vécu en direct le décès de Palmiro Togliatti, le dirigeant communiste italien, et cela m’a marqué, comme la mort de Kennedy, la façon dont il a été assassiné. Il existe chez moi une profonde humanité et je trouve lâche un tel acte. Comme, plus tard, l’assassinat de Boudiaf, qui avait été le premier adhérent du FLN. »
Michel Sportisse quitte l’Algérie en 1974 pour ses études. Il y reviendra souvent par la suite. « J’avais obtenu un brevet professionnel de comptable. J’ai donc fait des études de gestion à Bordeaux et ai obtenu un bac G2. Mais je n’aimais pas ce métier. Puis, moi le fils de moudjahidin, je me suis mis au pas de l’armée française. Sortir de mon milieu d’origine pour comprendre ce qui se passe ailleurs fait partie de ma nature. »
Après Bordeaux, le Midi et Paris, Michel s’installe à Vénissieux en 1977 et devient correcteur pour des journaux communistes, Le Point du jour et L’Humanité Rhône-Alpes. L’écriture lui sert surtout à écrire des articles sur les films qui produisent en lui une impression forte. Il cite ainsi Les Filles d’Olfa de Kaouther Ben Hania, « qui n’est ni un documentaire ni une fiction et est bouleversant ».
Le cinéma est sa passion et c’est à Alger, plus précisément à la cinémathèque, qu’elle est née. « C’était en 1970, j’avais 16 ans et ne comprenais pas tous les films que j’allais voir. J’achetais aussi toutes les revues qui venaient de France. Le cinéma est ma nationalité ! Il m’a permis de comprendre les problèmes de mon pays et que, partout dans le monde, on en connaissait de semblables. »
Souvenirs de la cinémathèque d’Alger
Un de ses premiers souvenirs cinéphiles est rattaché au film de Mario Monicelli, Les Camarades (1963), que son père lui avait fait découvrir. « Le cinéma italien m’a interpellé. Il était très politique et ses comédies traitaient de problèmes de tous les jours sur un ton satirique. On retrouve cela en Algérie avec les films de Merzak Allouache (Omar Gatlato) ou Mohammed Lakhdar-Hamina (Hassan Terro). Monicelli mais aussi Scola ou De Sica savaient se moquer des gens sans se montrer supérieurs. Comme si, quelque part, nous étions tous coupables. C’est aussi ce que fait Fellagh dans ses sketches sur l’Algérie. »
Cet amour du cinéma italien lui fait écrire deux ouvrages sur Ettore Scola et Mauro Bolognini qu’il publie au Clos-Jouve. Chez le même éditeur lyonnais, Michel Sportisse change de style cinématographique et publie, en mars dernier, Yannick Bellon, toute une tribu d’images. « Je me sentais concerné par son cinéma, ses sujets novateurs. Elle parle des femmes de condition modeste, proches de nous : l’épouse d’un cadre moyen dans La Femme de Jean, une infirmière dans L’Amour violé. Les films de Yannick Bellon parlent de problèmes actuels. »

Photo Emmanuel FOUDROT
Michel voyait aussi dans la construction du livre une belle occasion de parler de l’entourage de la cinéaste. « Il existait une vraie fusion entre la mère et ses deux filles. Ce n’était pas une famille classique avec la mère photographe, les deux filles comédienne et cinéaste. Et il faut encore parler de l’oncle, Jacques B. Brunius, et de ses échanges permanents avec elles. »
En plus de nombreux courts-métrages et documentaires, Yannick Bellon n’a tourné que huit longs-métrages. « Ce n’est pas une histoire d’hommes/femmes, d’hommes empêchant les femmes de travailler, mais de contenu. Grande actrice américaine, Ida Lupino n’a signé que sept films comme réalisatrice. Et l’actrice japonaise Kinuyo Tanaka n’en a dirigé que six. Ces femmes qui s’expriment disent des choses importantes sur notre société. Par nature, la femme est l’élément le plus révolutionnaire de la société. Elle occupe la place la plus sensible, la plus défavorisée. N’oublions pas que le machisme est une stratégie de la domination. Je réfute le terme réducteur de féministe. Je défends une société nouvelle avec des rapports différents, d’égal à égale. Je pense que Yannick Bellon partagerait ce point de vue, elle qui, dans La Triche, critique la façon patriarcarle de régenter la sexualité de la société en deux groupes, hétérosexuels et homosexuels. »
Parmi les nombreux sujets qui pourraient devenir des livres — il cite Vittorio De Sica ou la guerre d’Algérie —, celui sur le cinéaste René Vautier, cinéaste militant dont le film le plus connu est Avoir vingt ans dans les Aurès, semble le plus avancé.
 Yannick Bellon, toute une tribu d’images de Michel Sportisse, éd. Le Clos-Jouve, 130 pages, 24 euros
Yannick Bellon, toute une tribu d’images de Michel Sportisse, éd. Le Clos-Jouve, 130 pages, 24 euros

















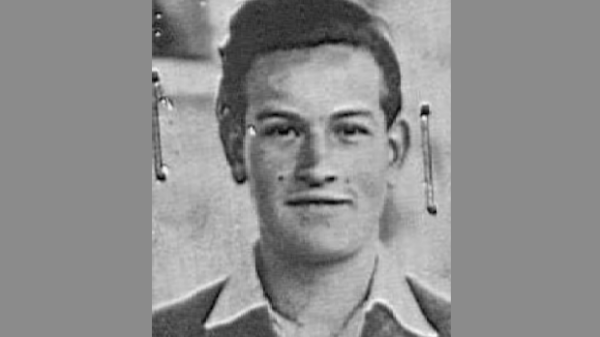


















Derniers commentaires