
Vers 1910, le café Terminus affiche fièrement sa belle terrasse et ses jeux de boules en bordure de la place Léon-Sublet.
Vendredi 29 avril 1763. À mille lieues au-delà des mers, le roi Louis XV vient de perdre le Canada et toute l’Amérique française, lors d’une bien funeste guerre. Mais ce n’est pas ce qui préoccupe Guillaume Quemin, tenancier d’un cabaret au Moulin-à-Vent. Lui est alité depuis des semaines, et craint que sa dernière heure soit arrivée. Alors, pour protéger les droits successoraux de sa femme et de leur fille, il prie le notaire de Vénissieux d’inventorier ses biens. Ainsi fait maître Izelin, qui nous donne l’occasion de pénétrer dans un débit de boissons du 18e siècle. Car derrière le mot de «cabaret», n’allez pas imaginer une salle de spectacle semblable aux Folies Bergère. Ce terme désigne les ancêtres de nos cafés et de nos restaurants, dans lesquels les hommes du village venaient les soirs et les dimanches boire un coup, croquer un bout de saucisson ou de fromage, jouer aux quilles, et discuter jusqu’à point d’heure, faisant de ces établissements l’un des hauts lieux de la sociabilité villageoise.
C’est donc ce type de cabaret que tenait Guillaume Quemin. Sa maison de quatre pièces lui était presque entièrement vouée. Il accueillait les clients sur les tables de sa cuisine, dans deux de ses trois chambres et surtout dans sa cour, où trônaient « trois tables [en] chene et sapin soutenues par deux piquets dans terre avec leurs bancs ». En somme, notre homme disposait déjà d’une terrasse de café. Que buvait-on chez lui ? Pas encore de café, car ce breuvage importé des Antilles restait alors réservé aux gens aisés. Par contre, il détenait dans sa cave deux gros tonneaux de « vin cléret » venu de Sérézin-du-Rhône, et devait sans doute aussi s’approvisionner à Vénissieux, qui croulait sous les vignes. Ses affaires allaient bon an mal an, le nourrissant mais guère plus, car Guillaume Quemin déclara au notaire qu’il n’avait chez lui aucune provision de blé pour nourrir sa famille, « et qu’il faut au contraire en acheter ».
En 1836, 15 cabarets pour 3000 habitants !
Le fait est que ce cabaretier affrontait une rude concurrence. Le premier recensement dressé dans notre commune, en 1836, cite en effet pas moins de 15 cabaretiers et cabaretières. Pas mal, pour un village d’à peine 3000 habitants : cela fait un cabaret pour 200 personnes ! Un peu comme si Vénissieux avait aujourd’hui… 336 cafés ! Certes, les clients d’antan n’étaient pas tous Vénissians. Aux côtés des établissements du Bourg, servant une clientèle locale, l’on comptait en effet une multitude de cabarets au Moulin-à-Vent, lesquels abreuvaient des voyageurs passant sur la grande route de Vienne et de Marseille, et aussi des foules d’ouvriers lyonnais profitant d’un vin moins cher que dans leur grande ville, car moins taxé. Ces clients donnaient bien du souci aux autorités. Ils restaient jusqu’en pleine nuit, se saoulaient, se battaient, et allaient même parfois jusqu’à provoquer des révoltes, comme en 1744. Du coup, la municipalité multiplia les tentatives pour juguler ces nuisances. En 1836, « dans l’objet d’obvier aux inconvéniens graves résultant de ce que les aubergistes et cabaretiers (…) se permettent de donner à boire et à manger à des heures indues, [ce qui] occasionne des querelles, des rixes, protège les gens sans aveu, favorise la débauche et l’inconduite et trouble le repos public », elle décida que désormais, les cabarets fermeraient leurs portes à 22 h, et ne les ouvriraient le matin qu’à… 4 ou 5 h !
L’âge d’or des troquets
Cependant, peu à peu, une mutation s’opère, qui voit les cabarets céder la place aux cafés et aux restaurants que nous connaissons aujourd’hui. Dès 1836, le recensement mentionne ainsi un aubergiste, qui alimente ses clients et les loge, mais aussi quatre cafetiers, servant la boisson reine de nos cafés actuels, en plus du vin de nos régions. Presque cent ans plus tard, le recensement de 1901 consacre la fin de cette évolution. Plus aucun cabaretier n’apparaît en ses pages, qui citent par contre un hôtelier – Emile Joly, exerçant au Bourg –, un limonadier, et surtout 17 cafetiers pour 3867 habitants, ce qui fait un café pour 227 habitants. Les troquets vivent alors leur âge d’or, surtout au Bourg où ils s’avèrent les plus nombreux, avec 10 établissements. Les cartes postales des années 1900-1920 nous les montrent, avec leur fière devanture et leur enseigne annonçant la couleur, comme pour le « café hôtel des Négociants », avenue Jean-Jaurès, le « café de la Mairie », place Léon-Sublet, ou encore le « café Terminus », qui lui fait face, avec sa belle terrasse et ses « jeux de boules ».

À l’hôtel de l’Avenir, qui était implanté route d’Heyrieux, pas question d’avaler seulement un bout de tomme ou de charcuterie comme dans les cabarets du XVIIIe. L’on y mange du bon, et du copieux.
Et les restaurants, dans tout cela ? La fin du XIXe-début du XXe siècle les voit naître, puisqu’en 1901 l’on en trouve déjà deux à Vénissieux, l’un au Bourg, tenu par François Bressieux, et l’autre à Parilly, tenu par Gabriel Barbier. Chez eux, plus question d’avaler seulement un bout de tomme ou de charcuterie comme dans les cabarets du XVIIIe siècle. L’on y mange du bon, et du copieux. Prenez l’hôtel de l’Avenir, implanté route d’Heyrieux à Parilly, dans les années 1910-1930. Lui sert une friture de poissons « tous les dimanches », offrant aux convives la possibilité de s’attabler sur sa « terrasse ombragée » par des platanes, et de profiter de ses « jeux de boules ». Mais l’on y fait aussi des « festins, noces et banquets ». La preuve ? Voyez ce menu, concocté ici même il y a un siècle. Il est typique des banquets interminables et surabondants de l’époque. Attachez-vous bien ! « Hors d’œuvre variés. Brochet mayonnaise. Volaille demi-deuil [truffée]. Haricots verts à l’anglaise. Poulets de grains rôtis. Entremets. Potage velouté. Champignons chantilly. Pigeons sur canapé. Glace. Fruits. Dessert ». Et le tout pour seulement 25 francs par personne. Miam !
Sources : Archives du Rhône, 3 E 11453. Archives de Vénissieux, 1 F 35/1 et /6, registre des délibérations municipales (1836). Collection personnelle : cartes postales de Vénissieux.

















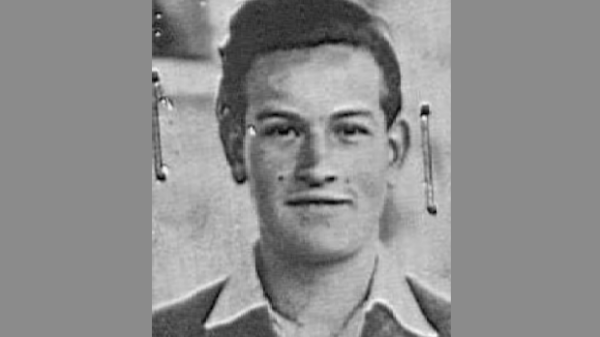



















Derniers commentaires