
Jean Cauwet avec les élus vénissians, dimanche dernier, lors de la commémoration de la libération des camps
Quand, en 1945, les armées alliées se sont rapprochées des camps d’extermination nazis, les SS ont voulu effacer toute trace de la barbarie. Ils ont contraint les déportés affamés à marcher sur des centaines de kilomètres, éliminant les plus faibles. Jean Cauwet a participé à une marche de la mort, entre le camp de Sachsenhausen et la forêt de Below, où il a trouvé refuge. Le Vénissian témoigne de cette épreuve, alors que l’on a célébré, dimanche dernier, le 66e anniversaire de la libération des camps.
Il est un signe reconnaissable entre tous, chez un résistant ou chez un déporté : la dignité qui émane d’eux. Jean Cauwet est un de ceux-là, déporté au camp de Sachsenhausen en 1943. Parlant de sa moralité et de son état d’esprit, sa fille Catherine le compare volontiers à Stéphane Hessel. Comme l’auteur de “Indignez-vous !”, Jean Cauwet possède cette droiture dans la posture et ce regard franc qui en imposent, sans qu’il cherche d’ailleurs à le faire. En ce 24 avril, anniversaire de la libération des camps, il est venu pour la première fois au cimetière de Vénissieux suivre cette cérémonie. A 91 ans, Jean Cauwet n’aime pas ressasser le passé et se tient à l’écart des honneurs. Seul un petit insigne sur le revers de sa veste indique le nom de Sachsenhausen.
S’il a tourné la page douloureuse, il a accepté de confier quelques souvenirs à “Expressions” seulement sur l’insistance de sa famille et de sa voisine du Moulin-à-Vent, Corinne Cavet-Petitjean. Les larmes aux yeux lorsqu’il remonte le fil de sa mémoire, celle-ci dit qu’il est “le papy que tout le monde voudrait avoir”.
“Je suis natif de la Meuse, commence Jean Cauwet. Nous habitions sur la Nationale 4, à égale distance de Paris et Strasbourg et je regardais souvent passer les marcheurs.” Si Jean mentionne la compétition de marche athlétique créée en 1926, c’est qu’il est lui-même un sportif convaincu, adepte du naturisme et d’une saine alimentation. Il fait du cross et se baigne tous les jours en eau froide. “Quand je suis arrivé au camp de Sachsenhausen et que j’ai vu l’inscription “Arbeit macht frei”, “le travail rend libre”, je me suis dit sans vanité aucune : si je ne m’en sors pas, personne ne s’en sortira ! A un moment donné, on sait exactement ce qu’on vaut !”
Mais nous n’en sommes pas encore là. Pour l’heure, en 1943, Jean Cauwet est un jeune sportif de 23 ans qui subit l’occupation allemande dans sa petite ville de Ligny-en-Barrois, travaillant dans l’entreprise familiale de vins et liqueurs. “Sur la place de Ligny, on avait fait les imbéciles avec des copains. On avait chanté la Marseillaise devant le monument aux morts et manifesté devant la Kommandantur. Nous avions l’intention de rejoindre Londres en passant par l’Algérie. Mais nous avons été dénoncés par un proche, qui devait partir avec nous. Un matin, j’entends la porte claquer et je vois un SS devant moi. Il recherchait un membre du groupe qui avait réussi à s’enfuir par les toilettes. J’ai été embarqué pour avoir participé à une manifestation anti-allemande.”
Jean est conduit à la prison de Bar-le-Duc puis transféré au camp de transit de Compiègne, “le début de l’horreur”. De là, un matin de 1943, on l’embarque dans un wagon à bestiaux. “On savait que les trains partaient, on ne savait pas où. Un comité de la Croix-Rouge nous donnait des trucs à manger hyper salés. Je me suis retrouvé avec des Marseillais du Vieux-Port, qui avaient une mentalité un peu spéciale. Sur le côté, il y avait une tinette dans laquelle il fallait faire ses besoins. Ils l’ont renversée et je ne vous dis pas l’odeur qui nous a accompagnés pendant les trois jours qu’a duré le voyage.”
“Quand j’étais au Club Med… «
Jean arrive à Oranienburg-Sachsenhausen, vite abrégé en “Sachso”. “De par le négoce de mes parents, je connaissais bien la tonnellerie. Quand on m’a demandé mon métier, j’ai répondu ajusteur. Cela m’assurait d’être placé dans un endroit où on aurait besoin de main-d’œuvre. Les Allemands ont fait mettre tous les ajusteurs en colonne : un sur deux partait pour le kommando où se fabriquaient les avions. Je n’y suis pas allé et j’ai eu de la chance : l’atelier a été bombardé, ils sont tous morts.” Malgré les conditions, Jean tient à conserver une certaine éthique. “Je refusais de manger des épluchures. On en aurait envoyé une en l’air, elle ne retombait pas !”
Il se retrouve n°65072 dans le SS Wassenhamptversuch (atelier d’essai dans la compagnie des SS). Les blocs où ils vivaient étaient disposés en éventail, autour de la place d’appel. “Il était marqué : “Les chemins de la liberté ont pour bornes l’obéissance, la discipline et l’amour de la patrie”. Moi, j’étais là parce que j’avais aimé ma patrie. Quand les nazis nous recomptaient et qu’il manquait un prisonnier, on restait immobiles tant que le compte n’était pas exact. Un Russe s’était planqué dans le système d’aération d’un bloc, nous sommes restés debout dans le froid jusqu’à 2 heures du matin. Une autre fois, dans un atelier, une presse était fendue. Les SS ont pendu séance tenante tous les gars de la presse. Dans le camp, il y avait aussi des maisons qui ressemblaient à des villas dans lesquelles se trouvaient des personnalités, mises à l’écart.”
C’est ainsi que sont passés à Sachso Georges Mandel et Paul Reynaud, le chef du gouvernement de la République espagnole, le fils aîné de Staline, mort en avril 1943 et Horia Sima, un des dirigeants de la terrible Garde de Fer roumaine, d’abord allié de Hitler puis interné là d’avril 1943 à août 1944.
À l’approche de l’Armée rouge, les SS fuient le camp entraînant avec eux des milliers de prisonniers qu’ils voulaient noyer dans la Baltique, après une marche de la mort. “On pesait tous 30 kg, les routes étaient réservées aux Allemands. Nous, on a marché sur le bas-côté pendant 200 km. Dès qu’un tombait, les SS lui logeaient une balle dans la nuque. On a marché ainsi sans chaussures, dans le bruit constant des détonations. Parmi nous, se trouvait le père Gartiser, qui était prieur de l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Lyon. Comme il était laborantin dans le camp, il avait pris des boîtes de Petri, ces boîtes transparentes peu profondes, qu’il remplissait de rosée. Cela nous a permis de subsister, en mangeant de l’herbe. Arrivés au bois de Below, les Allemands nous ont quittés. Les avions de la Croix-Rouge ont alors balancé des paquets de vivres, première nourriture depuis longtemps. Il y a eu 8500 morts sur la route, 11000 en comptant ceux qui sont morts de fatigue.”
Comment survivre à l’enfer et à la folie des hommes ? Peut-être en s’en occupant. Après la guerre, le père Gartiser fait venir Jean à Saint-Jean-de-Dieu où il devient infirmier psychiatrique. Il s’installe au Moulin-à-Vent en 1954 et y habite toujours, restant très discret quant à son passé de déporté. Quand il a éprouvé le besoin d’en parler, à certains moments de sa vie, Jean disait alors : “Quand j’étais au Club Med…” La dignité, toujours.

















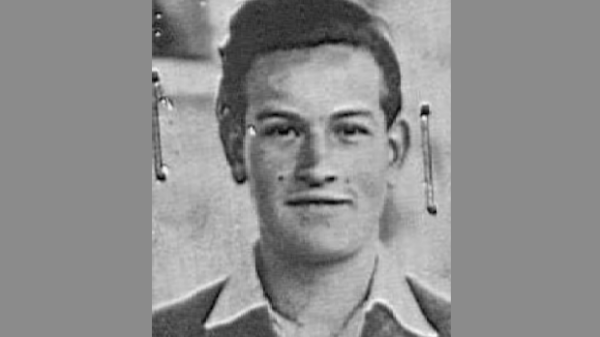




















Derniers commentaires