On aurait pu croire que sous l’Ancien Régime, Vénissieux était uniquement peuplé de paysans. Mais non, une foule d’artisans vivait aussi au village, travaillant quotidiennement pour tous ses habitants.
Bricoler, tout le monde savait le faire. Remettre un pieu en terre, désensabler le puits, réparer les rideaux du lit n’étaient pas très sorcier. Mais poser un toit sur la maison, fabriquer du tissu, transformer du cuir en chaussures, forger les outils de la ferme, ou tout bonnement presser de la bonne huile de noix étaient une tout autre affaire. Les Vénissians d’antan avaient beau être en bien des choses compétents, ils n’étaient pas pour autant doués en tout et devaient souvent s’en remettre à nettement plus habiles qu’eux. Acheter l’objet convoité, en se ruant chez un commerçant ? Encore eut-il fallu que le village en ait, ce qui ne fut pas le cas avant le XIXe siècle. Quant aux marchands de Lyon, l’on n’avait pas forcément une journée à perdre en trajets pour leur rendre visite. Et d’ailleurs à quoi bon ? L’on disposait à Vénissieux de tout ce qu’il fallait. Dans les hameaux du Moulin-à-Vent, de Saint-Fons, de Parilly, et plus encore au Bourg, habitait une pléthore d’artisans aptes à contenter tous les besoins du quotidien.
19 % des chefs de famille en 1836
Déjà présents à la fin du Moyen Âge, ces maîtres des métiers s’étaient peu à peu accrus au fil des siècles jusqu’à atteindre le nombre de 143 en 1836, soit 19 % des chefs de famille. Pas mal, pour un village d’à peine plus de 3 000 habitants ! Tous les corps de métier étaient alors représentés : l’habillement, avec les tisserands, les tailleurs, les cordonniers, les chapeliers ; l’alimentation, avec les meuniers, les boulangers, les bouchers, les “faiseurs d’huile” ; l’équipement de la maison, avec les maçons, les tailleurs de pierre, les charpentiers, les tuiliers, les menuisiers, les serruriers, les horlogers ; l’équipement de la ferme, avec les maréchaux-ferrants, les charrons, les bourreliers, les tonneliers.
Pour recourir aux services de ces spécialistes, deux moyens s’offraient à vous. Soit l’artisan venait à domicile. Comme le cordonnier Jean-Baptiste Caillot, un contemporain de Louis XVI, qui prenait ses outils et s’installait dans votre cuisine ou dans un coin de la grange pour réparer toutes les chaussures de la maisonnée, quitte à s’inviter à dîner voire à dormir chez vous, le temps que sa besogne soit faite. Ou alors, c’est le client qui se rendait chez l’artisan, comme nous le faisons aujourd’hui avec nos commerçants. En façade, la présence du maître était en principe signalée par une enseigne imagée, reproduisant les outils de son métier ou les objets qu’il fabriquait.
Un maréchal-ferrant arborait par exemple un bouquet de fers à chevaux, tandis qu’un boulanger accrochait au-dessus de sa porte un panneau sculpté ou peint de bien beaux pains. Juste en dessous, la façade s’ornait souvent d’une grande fenêtre ou d’une arcade en pierres, “l’arche de boutique”, destinée à prodiguer le maximum de lumière à l’intérieur, afin que le maître puisse travailler en voyant plus loin que le bout de ses doigts. Une fois passé la porte, vous pénétriez dans un atelier débordant d’outils, de matières premières, et d’objets terminés en attente de livraison. Ainsi en 1775, chez le tailleur Antoine Sublet, “dans un petit appartement [une pièce] ou il faisoit sa boutique, s’est trouvé une grande table bois noyer appelé en termes vulgaire un [é]tably, un coffre bois noyer dans lequel ne s’est trouvé autres choses que quelques vieux habits appartenant a divers particulliers qui les avoit remis pour racommoder, un grand cizau pour les tailleur, un petit, et un carro en fert tout pour ce metier”. Encore beau que cet Antoine Sublet se soit montré méticuleux, et n’ait pas fait déborder son activité sur les pièces avoisinantes. Habituellement, les ateliers des artisans avaient plutôt tendance à envahir les pièces d’habitation, mélangeant sans vergogne vie professionnelle et vie familiale. C’était le cas chez Louis Rogemont, un fabricant de cordes décédé en 1792, dont les peignes à chanvre, les rouets et autres “ustancilles dependant du métier de cordier”, s’entassaient dans un corridor longeant la cuisine, “ou le deffunt faisoit ses cordes”.
De pères en fils
Familial, le métier l’était aussi par son recrutement. Le maître besognait dans son atelier ou sur ses chantiers en compagnie de ses enfants, auxquels il avait appris le métier dès leur plus jeune âge. Ainsi, entre 1675 et 1700, le maçon Jean Berne travaillait-il avec ses fils Guillaume, François et Jean. Venaient-ils à se marier ? C’est d’abord dans les ateliers d’à-côté qu’ils cherchaient leur dulcinée. Comme le fit le forgeron Jean Picard en 1740, lorsqu’il épousa la jeune Marie Blajot, fille d’un autre maréchal-ferrant du village. Ainsi de pères en fils et de beaux-pères en gendres, se constituaient des dynasties de maîtres des métiers qui traversaient les siècles. Et si, par malheur, les enfants manquaient à l’appel, ou si le surplus de travail réclamait des mains supplémentaires, alors les artisans ouv-raient les portes de leurs ateliers à des apprentis ou à des ouvriers déjà formés, ceux que l’on appelait des “compagnons”. En pareils cas, les candidats étaient légion, car le métier d’artisan nourrissait plutôt bien son homme. La preuve : chez le boucher Charles Peyot, décédé en 1774, l’on retrouva dans sa cuisine, en ouvrant un grand coffre en noyer, “un sac de toile contenant 1 500 livres en or et en argent”, soit de quoi s’acheter au bas mot deux ou trois maisons. Quant au maçon Blaise de Villette, originaire de la Creuse et arrivé à Vénissieux en 1761 avec pour toute fortune un ballot de vêtements et d’outils, il affichait à la fin de sa vie, un patrimoine de six maisons ! Ce roi des ateliers s’était bâti au fil du temps tout un royaume.
Sources : Archives municipales de Vénissieux, recensement de 1836. Archives du Rhône, 3 E 11453, 11480, 11487, 11494.





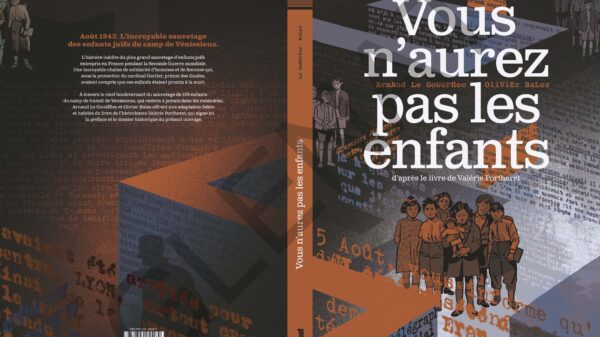



















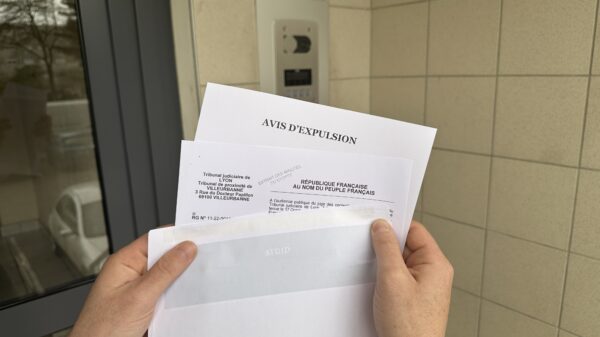










Derniers commentaires