Après la vente des autoroutes, la privatisation du loto pose une fois de plus la question de l’implication de l’État dans les services proposés aux Français. Un enjeu qui, à Vénissieux, fut déjà d’actualité il y a deux cents ans, au moment du partage des terrains communaux.

Ils existaient depuis le Moyen Âge, un temps si lointain que l’on ne se souvenait plus qui, des premiers seigneurs ou de leurs successeurs les rois de France, avait fait don de ces terrains. Depuis ce cadeau tombé du ciel, la commune de Vénissieux possédait de vastes parcelles que l’on appelait « les communaux ». Ils se situaient entre l’angle nord-ouest du plateau des Minguettes et les berges du Rhône, et s’étendaient sur 90 hectares – soit 900 000 m2, pratiquement cent fois plus que les maigres domaines détenus par bon nombre de paysans vénissians. Du coup, les habitants leur faisaient les yeux doux. Même si ces communaux étaient surtout composés de terres pauvres, de landes et d’anciennes îles où les eaux du Rhône s’invitaient à leur guise, grâce à eux, chacun pouvait mener son bétail paître l’herbe poussant dru, ramasser du bois pour la cheminée ou les besoins de la ferme, voire planter des arbres. Et le tout gratuitement. Les communaux étaient considérés comme un service public auquel tout Vénissian avait droit, et aussi comme un rempart contre la misère : sans eux, comment feraient les gens modestes pour avoir un troupeau ? Pour récolter du lait, faire du fromage et le vendre sur les marchés de Lyon ? Autant se couper une jambe plutôt que de s’en passer !
Pourtant, les communaux n’avaient pas que des admirateurs. Les esprits éclairés, les bien-pensants, les fortunés, ne voyaient en eux qu’un déplorable gaspillage d’espace. Chassez les gueux de ces trésors, et ils feront couler de l’or ! Partagez-les, vendez-les à des mains expertes, et les famines disparaîtront en moins de temps qu’il en faut pour le dire ! À partir du milieu du XVIIIe siècle, ce discours « progressiste » s’invite sur le terrain politique, et prend le pas sur les considérations de bien public. L’État lui-même encourage le mouvement, en incitant dès 1793 les communes à partager leurs communaux. À Vénissieux, l’on ne l’entend pas de cette oreille. Mais en même temps, les finances municipales battent de l’aile. En puisant dans les communaux, ne serait-ce qu’un petit peu, l’on renflouerait les caisses. Résultat, à partir des années 1820 la municipalité loue des portions des terrains collectifs à tel ou tel, surtout des gros propriétaires, les uns pour y planter des bois, les autres pour y installer des tuileries et des fours à chaux. Le doigt est à présent dans l’engrenage, il n’en sortira plus. En 1831, le sort des terrains ancestraux bascule. Par une pétition envoyée au préfet, « la presque généralité des habitans de Vénissieux demande le partage des biens communaux ». Le conseil municipal leur emboîte le pas, à l’unanimité des voix, « considérant que les communaux depuis longtemps, ne profitent qu’à un petit nombre de personnes [et] que cette propriété, rendue à l’agriculture, aura le double avantage d’augmenter ses produits et de les répartir également entre tous ses habitants ». S’y ajoute un argument de choc, qui n’a rien perdu de son actualité nationale : « la commune qui doit des sommes considérables, trouvera dans l’opération le moyen de s’affranchir [de se désendetter] », grâce aux taxes que verseront les bénéficiaires du partage…
Décidé dans l’allégresse générale, le dépeçage des communaux ne se fait pas pour autant facilement. En principe, tout chef de famille vivant à Vénissieux a droit à une parcelle. Colère immédiate du curé, considéré comme simplement de passage dans la commune, et écarté du partage. Stupeur aussi de l’huissier qui, bien que conseiller municipal, se retrouve mis de côté car il vit chez son père et n’est pas chef de famille. Mais les plus gros problèmes viennent de Joseph-Charles Mottard, le maître du relais de diligences (la « poste aux chevaux ») de Saint-Fons. Habitant Lyon et non Vénissieux, ce riche personnage ne peut prétendre à un morceau du gâteau. Mais comme il est l’un des plus gros propriétaires et qu’il a toujours profité du communal, il exige d’en avoir sa part. Et Monsieur Mottard de faire du pétard, d’écrire au préfet, de menacer les élus, et même de leur intenter un procès jusqu’à Paris. Rien n’y fait, le maire et ses conseillers tiennent bon. Le jeudi 14 juin 1832, les Vénissians se rassemblent donc sur la place du village pour assister au tirage au sort des 675 parcelles découpées dans les communaux, puis repartent, heureux, avec le papier concrétisant la réception de leur lot. Tout est-il pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Loin s’en faut. Sitôt leur cadeau reçu, bon nombre d’habitants le vendent pour gagner trois-quatre sous. Au point que bien vite, on ne compte plus que 250 propriétaires de lots issus du partage. Mais le pire reste encore à venir. Contre toute attente, le partage vénissian est déclaré illégal par le gouvernement… puis les propriétaires de lots sont forcés en 1841 de les acheter à la municipalité ! L’opération se révèle un désastre pour les Vénissians. Seuls les plus aisés y trouvent leur compte, notamment le fameux Mottard, de même que la municipalité dont les caisses sont partiellement renflouées. Ces évènements ont néanmoins une conséquence inattendue : sur les terrains désormais privés poussent moult maisons, qui donnent naissance au village de Saint-Fons. Un village qui se détache de Vénissieux en 1888, pour devenir une commune indépendante. Comme quoi, intérêts privés et intérêt public avaient chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Au point que deux siècles plus tard, le juste équilibre entre l’un et l’autre suscite toujours autant de débats.
Sources : Archives municipales de Vénissieux, 1 N 206 et registres des délibérations municipales, 1819-1850.

















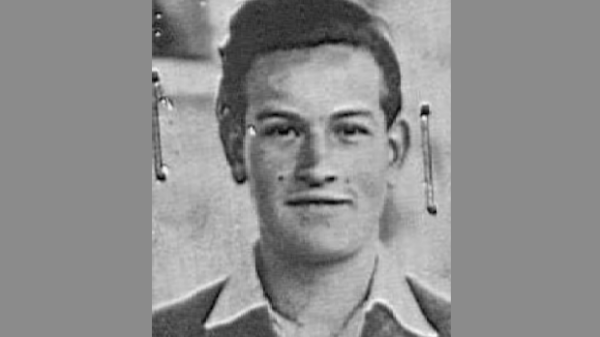


















Derniers commentaires