« Dis-moi comment tu t’habilles, je te dirai qui tu es. » Un proverbe qui a piqué notre curiosité. Alors, nous avons farfouillé dans les armoires du XVIIIe siècle, sorti les vêtements, compté les coiffes, et même déployé les robes de mariées : elles étaient d’une couleur que vous ne devinerez jamais…

Famille de paysans dans un intérieur, Louis le Nain, vers 1642
Le soleil s’est levé, tirant du lit le boucher Charles Peyot. Comme tous les jours, ce Vénissian du milieu du XVIIIe siècle ne se lave pas, et prend directement ses habits. Il commence par enfiler sa « culotte », une sorte de bermuda faisant aussi bien office de sous-vêtement que de pantalon court, puis couvre ses jambes avec des bas montant jusqu’aux genoux. Aux pieds, il met sa paire de souliers ornés d’une grosse boucle en fer ; s’il avait été un travailleur des champs, il aurait porté des sabots ou serait parti pieds nus, comme bon nombre de paysans n’ayant pas les moyens de s’offrir des chaussures. Maintenant, maître Peyot passe une chemise et enfile une veste. Le voici paré pour commencer son travail. S’il sort de sa maison, il jettera sur ses épaules un gros manteau de laine pour se protéger de la pluie et du froid, un luxe que seuls les habitants aisés du village peuvent se permettre. Surtout, comme tous les Français de l’époque, il mettra sur sa tête un grand chapeau, qui signera son statut d’homme et incarnera son honneur. Gare à celui qui le renverserait, par accident ou par défiance ! Pareille offense vaudra au maladroit de voir surgir son couteau…
Madame apparaît plus séduisante que son mari. Si elle ne porte pas non plus de sous-vêtements, elle se vêt d’une chemise et d’une robe à manches longues, qu’elle couvre d’un tablier sur le devant. Puis elle passe un « mouchoir de col », entendez un châle autour du cou, et garnit sa tête d’une coiffe plate avec des pans rabattus sur les oreilles, à la dauphinoise. Cette coiffe symbolise ses qualités de maîtresse de maison, aussi met-elle un point d’honneur à en changer à plusieurs reprises durant la semaine. Mais comme la lessive ne se fait que quelques fois par an, ce rythme impose d’en posséder toute une collection : comme Louise Blajot, qui en range 54 dans son coffre en noyer ; ou comme Catherine Chanoz, qui en aligne 72 dans son armoire, en plus de ses 48 chemises, de ses 12 tabliers et de ses 12 mouchoirs de col. La coquette ! Elle a dû économiser pendant des années pour s’offrir pareille panoplie, à faire pâlir ses voisines d’envie.
D’où l’expression « retourner sa veste »
Toutes ces nippes sont fabriquées par les « tailleurs d’habits » de Vénissieux, comme Pierre Sublet, auquel le paysan Claude Cristophle doit 22 francs en 1800, « pour façon et fourniture d’habits faits jusqu’à ce jour« , et qui obtiendra en guise de paiement, le labour de ses champs et deux charretées de bois. Les tissus utilisés proviennent pendant longtemps de Vénissieux, et sont alors qualifiés de « toile de ménage », ou bien des Terres-Froides, de Vienne et de Roybon, où se fabriquent des toiles de chanvre et surtout des « ratines », une étoffe de laine qui présente un aspect frisé. Particulièrement solides, ces vêtements se portent à longueur de vie. Bien sûr, ils s’usent petit à petit, deviennent « presque neufs », puis « mi-usés ». Le temps vient alors de les retourner, pour mettre à l’extérieur la face intérieure moins abîmée – d’où notre expression aux saveurs politiques : « retourner sa veste ». Ce subterfuge permet de freiner le moment de ramener ses habits chez le tailleur, pour rapiécer au mieux les parties élimées ou déchirées. Votre apparence en pâtit. Sur les textes de l’époque, que de vêtements aux allures de haillons ! En 1746, les habits du forgeron Pierre Blajot sont dans un tel état qu’ils « ne méritte pas etre évalués ». Pourtant, ces nippes continuent leur vie… sur le dos des enfants, habillés comme des petits hommes ou des petites femmes, à l’aide des tissus portés par leurs parents. Même les bébés, que nous parons aujourd’hui de superbes grenouillères, n’ont droit à l’époque qu’à des « drapeaux », autrement dit des tissus hors d’âge, passés par plusieurs générations avant de finir en chiffons. Car lorsque vous mourrez, vos nippes poursuivent leur chemin ; c’est même une tradition de donner au fossoyeur pour tout salaire, « les vieux vêtements dont était vêtu le défunt lorsqu’il décéda » !
Malgré ces habitudes coriaces, peu à peu l’habillement évolue. Passé le milieu du XVIIIe siècle, les étoffes maison cèdent la place à des tissus d’importation, des ratines de Paris, de Montauban, d’Elbeuf en Normandie, et même à des flanelles d’Angleterre. Surtout, luxe inimaginable quelques générations auparavant, apparaissent des pièces de soie et de coton, comme ces « indiennes » décorées de motifs peints en Asie, puis imitées dans les ateliers de Suisse et de la région lyonnaise. Dans le même temps, au lieu des teintes basiques et souvent sombres du règne de Louis XIV, fleurissent sous Louis XV et sous Louis XVI des bouquets de couleurs. Le brun, le noir, le blanc, se muent en bleu, en « prune », « olive », « vin », et même « cerise », un rouge vif qui a toutes les faveurs des jeunes femmes… pour leurs robes de mariées. Conséquence de cette révolution dans les garde-robes, apparaissent à Vénissieux des blanchisseuses et des repasseuses prenant soin de votre linge, et aussi une fabrique de chapeaux au Moulin-à-Vent, tenue à partir de 1765 par les bien nommés frères Chappel. Quant à Françoise Piot, elle ouvre en 1785 un commerce « de dentelles, mousselines, cotton, indienne, fil et coiffures, jupes et jupons ». Plus besoin désormais de se rendre à Lyon pour faire l’emplette des derniers articles à la mode. La ville s’est invitée au village. Et, sans s’en rendre compte, les Vénissians commencent à entrer dans notre société de consommation.
Sources : Archives du Rhône, 3 E 11442 à 11495.



















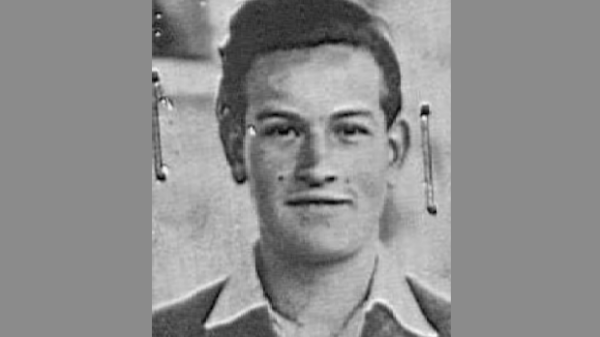





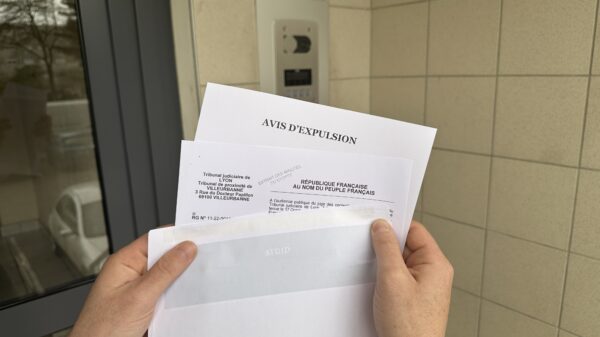









Derniers commentaires