
Camp de prisonniers de guerre allemands de Vénissieux/Saint-Fons (photo archives CICR)
Au moment de la Libération, Gisèle, âgée de 86 ans aujourd’hui, habitait Parilly. Elle n’a pas oublié les bombardements du printemps 1944, ni l’arrivée des troupes américaines, dans les premiers jours de septembre. Mais lorsqu’on l’interroge sur les prisonniers de guerre allemands, elle reste silencieuse. « On avait déjà bien assez de soucis comme cela. Je ne m’en souviens pas. » L’amnésie de cet épisode de la Seconde Guerre mondiale est quasi générale. L’ennemi était honni, on l’a donc éliminé de la mémoire collective. Pourtant, entre la fin de 1944 et l’été 1948, Vénissieux accueillit un camp de prisonniers, et pas des moindres : il comptait 8 000 hommes, soit la moitié de la population de la ville !
La décision de créer un camp en banlieue lyonnaise est prise par les autorités militaires entre septembre 1944 et janvier 1945. L’on dispose, à cheval sur Vénissieux et sur Saint-Fons et à portée immédiate de la voie ferrée de Grenoble, de vastes baraquements construits lors de la Première Guerre mondiale pour les besoins d’une usine d’obus, et que les nazis ont utilisés pour enfermer des Juifs avant leur déportation vers les camps de concentration. Ils serviront donc pour interner une partie du million de prisonniers que la France reçoit, au fur et à mesure que les Alliés libèrent notre pays puis s’avancent en Allemagne. Des convois ferroviaires les amènent jusqu’à notre ville, sous bonne garde. Malheur à ceux qui tentent de s’évader : le 25 février 1945, le SS Guido Siegert est abattu d’une balle dans la tête, alors qu’il s’échappait par le fenestron d’un wagon. Face à cet ennemi détesté, l’on ne fait pas de quartier. Peu à peu, leur vie s’organise au camp. Le réveil a lieu à 5 heures du matin, suivi par un appel interminable à 5 h 40, puis par une journée d’ennui, à tourner en rond dans le camp ou à rester dans les baraques, couché sur des planches recouvertes d’un sac de paille. Les repas interrompent la monotonie, même si la pitance des prisonniers souffre des privations du temps : ils reçoivent en tout et pour tout 300 grammes de pain et 100 grammes de pommes de terre par jour, plus 50 grammes de viande par semaine. Les corps maigrissent, et flottent dans des uniformes qui s’usent chaque jour un peu plus, et finissent par tomber en lambeaux. Tant pis pour eux ! « Il est juste, rappelle le préfet du Rhône en juin 1945, que les vexations dont ont pu souffrir nos soldats prisonniers en Allemagne, soient endurées à leur tour par les prisonniers allemands. »
« Faites relever vos ruines par ceux qui en sont responsables. Faites embellir vos cités par ceux qui voulaient les détruire »
Pourtant, petit à petit, les rapports avec l’ennemi changent. La France entend utiliser les « PGA », comme on les appelle (Prisonniers de guerre allemands), pour travailler dans les champs, dans les usines, et surtout pour reconstruire le pays : « Faites relever vos ruines par ceux qui en sont responsables. Faites embellir vos cités par ceux qui voulaient les détruire », proclame une brochure officielle. La population et les industriels sont donc invités à manifester leurs besoins de main-d’œuvre auprès de la mairie. Et les sollicitations affluent. Dès février 1945, M. Barse, « cultivateur-grainier, nous a présenté une demande en vue d’obtenir des travailleurs prisonniers de guerre de l’Axe ». Puis vient le tour de la Verrerie ouvrière, des Ateliers et forges de Vénissieux, des usines Berliet, de la commune elle-même, comme l’écrit le maire Louis Dupic, le 26 février 1945 : « j’ai obtenu au début de janvier, qu’une équipe de 15 prisonniers de guerre de l’Axe, du camp 431 de Vénissieux [n° 141, en fait], soit mise à ma disposition pour l’enlèvement des neiges. Ensuite, j’ai conservé ces hommes pour effectuer divers travaux de voirie. Actuellement, ils sont employés au creusage de trous et transport de terre pour des plantations d’arbres ». Chaque matin, ces « kommandos » de PGA quittent le camp puis rejoignent leurs chantiers, où ils travaillent sous la responsabilité de leurs employeurs. À eux de les surveiller, de les houspiller s’ils traînent des pieds, et d’empêcher les évasions. Le maire l’apprend à ses dépens, lorsqu’il reçoit une amende de 1 500 francs pour avoir laissé filer le soldat Heinrich Schumacher, en février 1947.
Les derniers prisonniers partent au cours de l’été 1948. Mais pour 127 d’entre eux, notre ville devient la dernière demeure
Mais ces évasions restent relativement rares. À la détestation des moments de la Libération succède une coexistence froide, puis des rapports humains presque normaux, au fur et à mesure que les mois et les années s’écoulent. L’on commence par voir des PGA circuler à vélo dans les rues de Vénissieux, alors même qu’ils pourraient s’échapper plus facilement avec ; puis ils paraissent à la terrasse des bistrots, où ils viennent dépenser le petit pécule que leur versent leurs employeurs ; en avril 1947, une usine signale ainsi « qu’un de nos PGA, ayant escaladé le mur de notre établissement, s’est rendu au cinéma. D’autre part, deux de nos PG ont été vus au café « Le Petit Turin », sans qu’il nous ait été possible de savoir lesquels il s’agissait ». La population elle-même pactise avec les prisonniers, que les habitants connaissent de mieux en mieux. Au camp, la vie s’organise aussi. Les Allemands suivent des cours, constituent une bibliothèque, forment un orchestre, participent au culte dans un temple protestant, et même organisent des compétitions sportives, comme en juillet 1947. Depuis septembre 1945, ils sont aussi soignés dans un hôpital ouvert exprès pour eux à Vénissieux, et confié à des médecins de leur nationalité. Pourtant, tout n’est pas rose pour les PGA vénissians. Même si le courrier et les colis reçus avec parcimonie — deux lettres de 24 lignes, et quatre cartes postales de 7 lignes par mois –, permettent d’échanger des nouvelles avec leurs familles, le mal du pays et la longueur de la captivité finissent par peser sur les anciens ennemis. Certains sombrent dans le désespoir et se suicident, comme Karl Pelkowski, décédé à l’hôpital le 26 mai 1946, après avoir avalé une grosse quantité d’alcool frelaté, ou comme le sergent Herbert Melhorn, originaire de Fulda, près de Francfort, que l’on retrouve pendu le 12 février 1948.
Enfin arrive le temps de la liberté. Même si la France souhaite encore garder la main-d’œuvre allemande à sa disposition, le début de la guerre froide avec l’URSS impose de normaliser les relations diplomatiques entre les ennemis d’hier, et pour cela de relâcher les prisonniers. Dès janvier 1947, huit soldats du commando employé par la commune sont réintégrés au camp, « en vue de leur rapatriement en Sarre ». Les derniers prisonniers quittent Vénissieux et Saint-Fons au cours de l’été 1948 semble-t-il. Mais pour 127 Allemands, notre ville devient la dernière demeure. Décédés à l’hôpital au cours de leur captivité, ils sont inhumés dans un carré spécial du nouveau cimetière. Ils y restent jusqu’en 1958, date à laquelle les corps sont transférés dans l’immense cimetière allemand de Dagneux, près de Montluel, dans le département de l’Ain. Ils reposent toujours dans ces lieux, parmi leurs 20 000 camarades.
Sources : Archives municipales de Vénissieux, 4 H 104/2.

















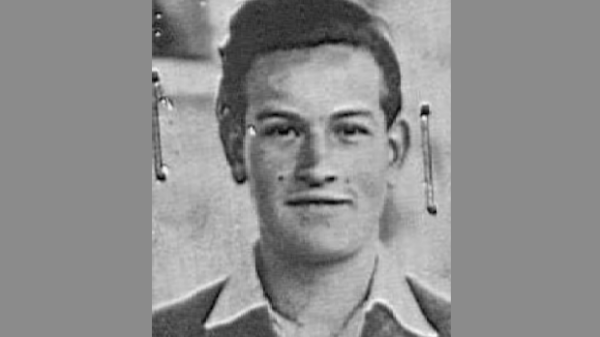


















Peronard M.
11 mars 2021 à 10 h 40 min
Il semble certain que ces PGA ont été au combien mieux traités que les prisonniers de l’Allemagne nazie. Et tant mieux pour eux, et surtout pour la dignité de la France qui ne s’est pas rabaissée au niveau de l’ignominie nazie.
Nicoandry
15 octobre 2020 à 19 h 29 min
Bravo pour cet article !
Très heureux d’avoir pris connaissance de ces quelques anecdotes
concernant cette période si particulière de l’Histoire de la ville.
Certains prisonniers mais rares d’ailleurs, sont restés en France après leur captivité,
pour y fonder leur nouvelle famille.
Nicolas Andry – Auteur du livre « Objectif Lyon ! »
avec présentation de photos inédites sur l’avancée allemande dans la région en 1940.