Lorsque nous étions gones, mes copains et moi adorions cueillir les petites prunes sauvages qui poussaient dans les haies d’épineux délimitant les champs, tout près de Parilly. Elles avaient une aigreur à faire dresser la queue d’une biquette mais elles faisaient notre goûter et nous en mangions un cuchon – tant pis si quelques heures plus tard, elles nous donnaient la brûle et nous rendaient tout barbouillés, puis nous valaient une avoinée de la part de nos parents. Ces prunelles sauvages, nous les appelions des « plosses », un mot dont j’étais persuadé que nous l’avions inventé au cours de nos balades. Ce n’est que bien plus tard, aux portes de la retraite, que j’ai retrouvé ces plosses sous la plume d’un savant.
Ce mot ne sortait pas de l’imagination de moufflets. Il provenait d’un autre temps, des siècles où les Vénissians et tous les habitants de la région lyonnaise ne parlaient pas le français mais une langue à mi-chemin du parlé de Mistral et de celui de Voltaire : le franco-provençal. Ce franco-provençal qui n’était pas un patois mais une langue à part entière, avec ses livres et ses auteurs, ses poèmes et ses chants. On le parlait en Piémont et en val d’Aoste, dans l’ouest de la Suisse, dans le sud de la Bourgogne, en Lyonnais, en Isère et jusque dans le nord de la Drôme, où l’on quittait son aire de prédilection pour entrer dans les terres du provençal et de la langue d’oc. Traversant la France au cours du 16e siècle, un voyageur parisien résuma ces frontières linguistiques d’une phrase : « En arrivant à Mâcon j’ai cessé de comprendre, et en arrivant à Valence j’ai cessé d’être compris ».
Même s’il est enseigné dans certaines universités, il ne reste plus guère de personnes pour comprendre le langage utilisé dans le temps par les Vénissians. A part quelques passionnés militant dans des associations, et des personnes âgées habitant dans des hameaux perdus sur les montagnes du Val d’Aoste, le franco-provençal est devenu une langue étrangère pour la plupart d’entre nous. Pour preuve, lisez ce poème d’un Grenoblois tout décati tellement il était perclus de rhumatismes, et qui s’appelait François Blanc dit La Goutte (1662-1742). J’y donne qu’un extrait car le bougre a une tchatche et barjaque à tel point qu’il tapisserait toute une charrière (une rue) avec ses pages. Et pour les lecteurs qui n’y comprendraient goutte, la traduction figure en bas de cette page :
« Quan ben ne vou chaut ren, de la gen de ma sorta,
Je voudrin bien povey faire uvri voutra porta,
Intra chieu vou, Monsieur, vous leva mon chapet,
Vous rendre mou devey, vou zuffri mon respect,
Mais d’avez ce l’honnou l’esperanci s’envole,
Je seu tout rebuti, la goutta me désole,
Je ne poey plus marchié, décendre ni monta
A pompon-lorion je me foey charronta,
A pena din le man poey-je teni mon libro,
Je n’ai plu que lou zieux et quatre deigt de libro ».
L’orthographe est étrange, certains mots complètement de bizangoin, et pourtant, prononcée à voix haute, cette tirade parait moins de traviole qu’il n’y paraît ; essayez seulement : à deux-trois mots près vous verrez qu’elle est d’aplomb, comme cette page que vous êtes après de lire, et que j’ai déjà truffée autant que je le pouvais, de franco-provençal – ce sont les mots en italiques. Je n’en ai pas mis des pataflées, pour ne pas vous faire fuir à la bade vers le reste du journal, mais juste assez pour vous faire prendre conscience que vous continuez sans le savoir, à parler la langue des Vénissians d’autrefois. Le franco-provençal a beau avoir été interdit il y a près de cinq siècles – c’était en 1539, lorsque l’édit de Villers-Cotterêts rendit le français obligatoire dans les actes officiels –, il resta pratiqué parmi les gens du peuple jusqu’au début du 20e siècle.
Au 16e et au 17e siècles, il n’y avait que les monchus (les gens riches), ceux qui jouaient les coqs de village avec leur beau paltot en guise de plumage, et leurs harpions (griffes) plantés sur le tas de fumier, pour parler comme un Molière en scène. Les autres Vénissians, les affaneurs (ouvriers agricoles), les méareurs (locataires d’une ferme), les picabois (charpentiers), les cordannots (cordonniers) ou les canabassiers (tisseurs de chanvre), bref les gens comme vous et moi, ne mettaient dans leur bec que « la langue vulgaire », comme disaient ces messieurs de l’Académie. Et en plus, ils roulaient les « r » comme leurs cousins du Midi : ainsi Barthélémy se prononçait Balthémy, et Bermont… Belmont. Puis petit à petit, les villageois un tantinet aisés se mirent à imiter les gens de la bonne société, et introduisirent à leur tour le français dans leurs conversations. Lentement le vocabulaire et la grammaire des Parisiens progressèrent sur nos terres dauphinoises. L’école de Jules Ferry acheva la conquête chez les gones confiés à sa garde, quitte à asticoter les plus ramiers : « tu me fais fliques ! Si tu parles patois, tu vas recevoir », durent menacer plus d’un maître.
Que reste-t-il aujourd’hui du franco-provençal ? En dehors des associations qui bataillent pour sa survie, environ une cinquantaine d’expressions ou de mots isolés, gardés dans le langage courant et que l’on prend pour de l’argot, souvent à tort. En voici un petit florilège.
Après avoir fait cramer les matefaims, j’ai payé la pogne que le boulanger a posée sur la banque : en plus des bugnes, elle servira de dessert au dîner de midi ou au souper de ce soir – mais c’est affreux ce qu’elle est chère. Je dois aller au rhabilleur, après le gnon qu’un branquignole, un ramier débraillé et tout mâchuré (saoul) à force d’avoir vidé des pots de Beaujolais, m’a donné sur l’épaule – tout cela parce que je me suis plaint qu’il faisait trop de bataclan. Eh ben mon cayon (mon cochon), tu aimes la pétafine (le fromage fort) !
Et puis encore ces perles héritées du passé : gadin (cailloux), nant (torrent), molard (butte, colline), à croupeton (accroupi), avoir le bocon, avoir la crève (être malade), être tout bougeon, chougner, miron (chat), niaquer (mordre), vogue, tomme (un fromage, et pas seulement de Savoie), serve et boutasse (mares), une patte (chiffon), emboucaner (sentir mauvais), potafiner, rapetasser (raccommoder). A l’heure où l’on sauvegarde les monuments de pierre légués par les siècles, ces mots font aussi partie de notre patrimoine. Parlons-les. Ne les oublions pas. Si infimes soient-ils, ils appartiennent à la culture de cette ancienne province que l’on appelait le Dauphiné.
Traduction en français du poème de François Blanc dit La Goutte :
« Même si vous ne vous souciez pas des gens de ma sorte,
Je voudrais bien faire ouvrir votre porte,
Entrer chez vous, Monsieur, ôter mon chapeau,
Vous rendre mon devoir, vous offrir mon respect,
Mais d’avoir cet honneur l’espérance s’envole,
Je suis tout rabougri, la goutte me désole,
Je ne peux plus marcher, descendre ni monter,
Sur le dos de quelqu’un je me fais charrier,
A peine dans la main je puis tenir mon livre,
Je n’ai plus que les yeux et quatre doigts de libres »

















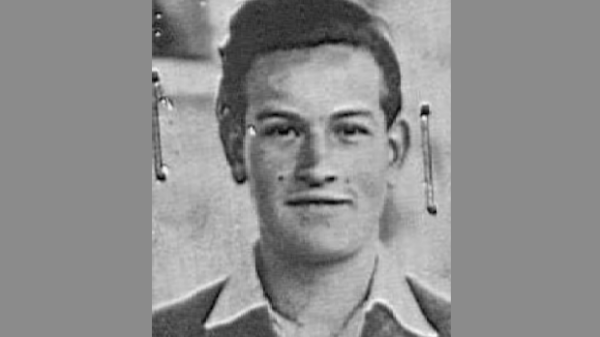



















mireille chevassus
26 avril 2015 à 8 h 31 min
bonjour. Merci pour ce cours d’histoire . J’utilise encore régulièrement certains de ces mots .