 Le 21 mars prochain marquera le 125e anniversaire d’une douloureuse séparation : le divorce de Saint-Fons et Vénissieux, qui se retrouve amputée du tiers de son territoire – soit plus de 600 hectares, et perd presque toutes ses usines.
Le 21 mars prochain marquera le 125e anniversaire d’une douloureuse séparation : le divorce de Saint-Fons et Vénissieux, qui se retrouve amputée du tiers de son territoire – soit plus de 600 hectares, et perd presque toutes ses usines.
Au début ce n’était qu’une source jaillissant au pied du plateau des Minguettes. Elle coulait plus généreusement que n’importe quelle autre dans la commune, au point de faire tourner la roue d’un beau moulin à grains. A cette claire fontaine, les Lyonnais des siècles passés vouaient un véritable culte. Ils y venaient en pèlerinage le dimanche des bugnes, juste après mardi-gras, pour s’amuser joyeusement en croquant les fameux petits gâteaux. De là vint peut-être le nom que l’on donna à cette partie de Vénissieux : Saint-Fons, comme une sainte fontaine. Tout près de la source une voie romaine, érigée plus tard en chaussée royale puis en Nationale 7, étirait ses ornières et son pavé sans fin de Lyon à Vienne et de là à Marseille. Comme il fallait changer régulièrement les chevaux épuisés à force d’avoir galopé, on construisit aux 15e-16e siècles au carrefour de la route et de la source, un grand relais de diligences servant aussi d’hôtel aux voyageurs. Ajoutez au tableau deux-trois fermes isolées, quelques fabriques de tuiles et vous aurez bouclé le tour de ce qui ne fut pendant des siècles qu’un modeste hameau de Vénissieux, coincé entre le Rhône et les pentes du plateau, vivant à l’écart du reste du village.
Sa situation change radicalement au cours du 19e siècle. En quête de grands espaces pour implanter leurs nouvelles usines, et chassés du quartier de Perrache où les odeurs de leur chimie empuantissaient l’air, une nuée d’industriels se rue sur les plaines de Saint-Fons. Entre 1847 et 1883, MM. Perret, Picard, Durand, Rendu, Monnet et bien d’autres encore font pousser fours et entrepôts, ateliers et cheminées comme des champignons dans les prés. L’occident vénissian prend des allures de ville du Far-West, surgie du néant en deux temps trois mouvements. Du coup l’ancien hameau qui ne comptait qu’une poignée d’habitants au 18e siècle, en accueille 1790 en 1872, et même 2283 en 1881, soit près de la moitié de la population communale.
A ses débuts, le nouveau quartier ressemble plus à un bidonville qu’aux belles rues de la Presqu’île, d’autant qu’il n’est peuplé que d’ouvriers sans le sou, pour la plupart d’origine italienne : « ils se logeaient où ils pouvaient, entassés père, mère avec 3 ou 4 petits enfants, dans une chambre unique ou le même taudis ». Le temps passant, les migrants se fixent, vendent les lopins qu’ils détenaient là-bas en Italie et investissent dans leur nouvelle patrie ; les chemins boueux de Saint-Fons se hérissent de maisons dignes de ce nom, forment des rues, des placettes, bref une petite ville.
Au sein du vieux village, la mue soudaine du Far-West sainfoniard provoque des grincements. Les Vénissians de souche considèrent le nouveau quartier comme une protubérance malsaine ; ils lui reprochent d’avoir détruit la plaine et les rives du Rhône, pollué l’atmosphère et les terres agricoles, tout en amenant dans la commune une marée de gueux mal famés. Extraits : « les usines installées à Saint-Fons sont presque toutes insalubres et dangereuses » ; leurs « vapeurs et fumées d’acide brûlent fréquemment les récoltes » ; quant à sa population, « essentiellement cosmopolite et nomade [elle] se compose d’artisans, d’ouvriers étrangers ne faisant qu’un court séjour, allant où le travail donne, n’ayant aucun souci du foyer domestique ». Evidemment ces immigrés ne disposent pas du droit de vote et ne siègent pas davantage au conseil municipal. En mairie, on fait comme s’ils n’existaient pas. Ils réclament la construction d’une église ? On la leur refuse, en 1866. Idem pour la poste, la gendarmerie, l’école de filles, l’asile de vieillards et même le cimetière, dont sont privés les Sainfoniards. Ils se plaignent au préfet de ne pas voir la couleur des deniers publics ? Ils sont déjà bien assez riches, qu’ils ponctionnent leurs patrons ! Les grands industriels justement, ne sont pas mieux traités par la municipalité : conscients des risques que représentent leurs usines, ils demandent en 1870 la création d’une brigade de sapeurs-pompiers. Refus catégorique des élus.
La question des pompiers est la goutte qui fait déborder le vase ; elle met le feu aux poudres et déchaîne une tempête politique entre les deux parties de la commune. A l’ouest, les usiniers nomment à leur tête un patron de la chimie, Lucien Picard (1838-1918), dont la belle demeure, le « château Picard », campe fièrement sur les pentes des Minguettes. Dès 1872, Picard et ses amis portent au préfet une pétition exigeant la création d’une nouvelle commune à Saint-Fons.
Sa démarche est la première d’une longue série : en juillet 1884, Picard remet une énième pétition forte de 676 signatures, puis de nouveaux quatre autres en août 1884. A l’est, les « unionistes » du vieux village répondent à cette bataille des plumes par un déluge de signatures. Peine perdue, leurs adversaires sécessionnistes disposent d’un stock de munitions inépuisable : « aux heures de sortie des usines, des émissaires à la porte recueillaient les signatures ; tous les ouvriers et employés ont ainsi subi une véritable contrainte, au moins morale ; de plus les porteurs des pétitions sont passés dans chaque maison, et là le chef de famille signait non seulement pour lui et sa femme, mais pour chacun de ses enfants » ! Le préfet répond aux uns et aux autres en désignant des enquêteurs chargés de recueillir l’avis général et de se prononcer sur l’opportunité d’un divorce des communes. Premier nommé, le maire de Bron se prononce pour, tandis que son successeur le maire de Villeurbanne s’oppose à la scission…
Pendant ce temps le Conseil général du Rhône compte les coups. Des compagnies comme Saint-Gobain bénéficient évidemment d’appuis politiques aux côtés desquels les paysans du conseil municipal ne pèsent pas bien lourd. La ville de Lyon a elle aussi choisi le camp sécessionniste : depuis 1874, elle multiplie les tentatives pour annexer les communes de la banlieue à son territoire ; si Saint-Fons se détache de Vénissieux, elle lui réservera le meilleur accueil… Au village, les rapports entre les deux camps deviennent de plus en plus tendus. Les démissions de conseillers municipaux se multiplient et les insultes fusent, les Vénissians se proclamant Républicains et traitant leurs opposants de roitelets cléricaux monarcho-socialistes !
La guerre de sécession finit par arriver sur les bancs de l’Assemblée nationale et du Sénat. Après quelques ultimes péripéties, le 21 mars 1888 les sénateurs votent à l’unanimité le divorce de Vénissieux et de Saint-Fons. Vénissieux se retrouve amputée du tiers de son territoire – soit plus de 600 hectares, et perd presque toutes ses usines. L’industriel Prosper Monnet devient le premier maire de la nouvelle commune. Perspicace, son désormais collègue de Vénissieux avait pris soin de publier un an auparavant un livret pour la circonstance : Adieux de Napoléon Sublet, maire de Vénissieux, à la population de Saint-Fons.
Sources : Archives municipales de Vénissieux, cote 3 D 17, et registres des délibérations municipales, 1858-1890.



















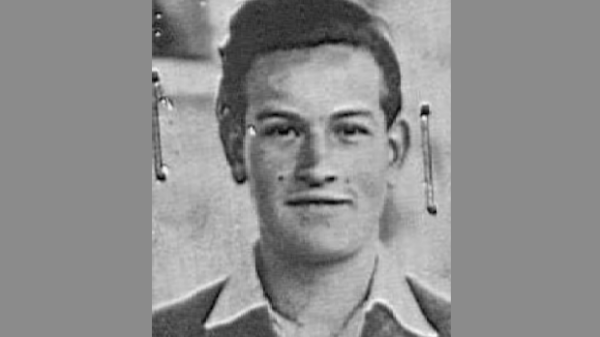





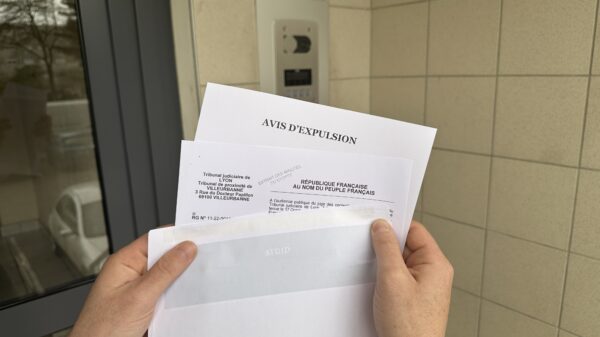









Derniers commentaires