
« Le sac de Lyon par les calvinistes » – vers 1565 (peintre inconnu). Tableau exposé au musée Gadagne à Lyon.
1576. Quatorze ans déjà, que le royaume de France endurait ces maudites guerres de Religion. Elles avaient commencé chez nous par l’assassinat, en avril 1562, du lieutenant-général La Motte-Gondrin, un catholique, et surtout chef des armées du roi en sa province du Dauphiné. Ces fieffés protestants l’avaient transpercé de leurs épées à Valence, puis avaient jeté son corps par une fenêtre. Ce meurtre mit le feu aux poudres, les protestants, menés par le sinistre baron des Adrets, multipliant les destructions et les combats à travers la région : ainsi, ils incendièrent la Grande-Chartreuse, détruisirent en partie l’abbaye de Saint-Antoine, ou encore canonnèrent les remparts protégeant la cathédrale de Lyon. La preuve, voyez cette rue de la Brèche, faisant face à Saint-Jean : elle doit son nom à cet épisode des guerres. Évidemment, les Huguenots furent aussitôt suivis et imités par les troupes catholiques.
Dès lors, le Dauphiné se vit soumis à d’incessants passages de soldats et à un cortège de dévastations, lesquelles entraînèrent des famines mais aussi des épidémies de peste, comme celle qui décima la France en 1564 et qui, toutes cumulées, firent des millions de morts. Le roi Henri III (1551-1589) tenta pourtant de mettre fin à ces maux. Le 6 mai 1576, il signa la paix de Beaulieu, par laquelle il reconnaissait aux protestants le droit d’exercer leur culte librement et pacifiquement. Mais le parti catholique s’éleva aussitôt contre cette décision, et forma une Ligue opposée au roi. Henri III tenta alors de ramener le calme en réunissant en décembre 1576 des États généraux en son château de Blois. Formés par des députés du Clergé, de la Noblesse et du Tiers État, ces États généraux furent précédés par la rédaction de cahiers de doléances, comme lors des États généraux de 1789, dans lesquels les sujets de Sa Majesté purent porter à sa connaissance les troubles qu’ils subissaient.
Cahiers de doléances
Ainsi fut fait à Vénissieux. Après s’être assemblés à son de cloche au-devant de l’église paroissiale, les Vénissians confièrent à l’un d’eux, probablement le notaire, toutes leurs plaintes, aussitôt consignées sur deux grandes pages. En bons Français, ils commencèrent par dénoncer le poids des impôts pesant sur eux : « Plaise entendre, dit le cahier, que les pauvres habitans de Venissieu ont été comme encore ils sont, grandement surchargés des tailles [le principal impôt royal], levées et deniers et autres tributs emprunts et autres charges ». Dame, il fallait bien financer la guerre ! Et c’est vrai que jamais dans l’histoire du royaume, les impôts n’avaient été si élevés. Mais ils dénoncèrent aussi le fait que les roturiers du village étaient les seuls à en payer. Les riches bourgeois de Lyon possédant des biens au soleil par chez nous, de même que les nobles et les ecclésiastiques, n’en versaient pas un centime : « les lyonnois et estrangiers ne veullent payer tailles royales negociable, tributs, emprunts, levées de deniers en aulcune manière » !
Satanés soldats !
Puis ils abordèrent le mal dont ils souffraient le plus : le passage des soldats. Pour son bonheur en temps de paix, mais pour son malheur en temps de guerre, Vénissieux était située sur l’une des principales routes du royaume, reliant Paris à Marseille, l’ancêtre de celle que l’on nommait encore il n’y a pas si longtemps, la Route nationale 7. Sur cette route passaient et repassaient sans cesse les troupes de l’un et l’autre camp, protestants comme catholiques, qu’il fallait ravitailler ou même héberger au village lorsqu’ils faisaient étape. « Ils sont grandement surchargés, dénonce le cahier, tant des estappes que passages de gendarmerie [de soldats] venant de France ou bien d’Ytallie pour aller en France, et dès lors qu’ils sont arrivés en la Guillottière, leurs logis sont dressés au dit lieu de Venissieu ».
Autant accueillir le diable chez soi ! Ces soldats ou ces mercenaires se comportaient comme en pays conquis, pillant les réserves, malmenant les habitants, volant le bétail. Voyez ce paysan de Solaize, tout à côté de Vénissieux, qui se plaint d’avoir perdu son cheval, capturé par un soudard : il en sortit à demi ruiné. L’on redoute tellement ces déplacements de troupes, que le propriétaire du château de Feyzin n’hésite pas à renforcer ses remparts pour s’en protéger. Faire partir ces soldats du village ? Oui, c’est possible, mais en payant une rançon aux officiers qui les commandent : « pour les fere deloger, se plaint le cahier, convient composer avec leurs capitaines, lieutenants fourriers, commissaires et aultre qui les conduysent, en bonnes et notables sommes de deniers quil leur convient demprunter de leurs voysins a grands intérêts, de manière que c’est leur totalle ruyne ».
Résultat de ces guerres et de leurs corollaires, les Vénissians passent d’un seul coup de la Renaissance à la misère la plus profonde. Forcés d’emprunter pour affronter leurs charges et pour nourrir leur famille, ils en arrivent à vendre leurs terres à leurs prêteurs, et à s’appauvrir encore plus. Au point « qu’ils ne tiennent et ne possèdent [plus que] la quarte partie [le quart] des possessions situés en leur village, la plus grande part d’icelles sont tenus et possedes par les lyonnois ». Et le cahier de conclure, que nombre d’habitants « sont contraints absenter leur lieu et se retirer ailleurs pour y vivre de leur travail et labeur ».
Ces malheureux n’étaient pas au bout de leur peine. Les États généraux de 1576 ne parvinrent pas à résoudre les maux du royaume. Bien au contraire, la paix conclue en mai de cette année avec les protestants fut jetée aux orties, et la guerre recommença de plus belle. Elle ne fut résolue qu’en 1598, après 37 années de conflits, lorsque le roi Henri IV signa le célèbre Édit de Nantes.
Source : Archives municipales de Vienne, AA 7/6. Remerciements à Magali Guénot.





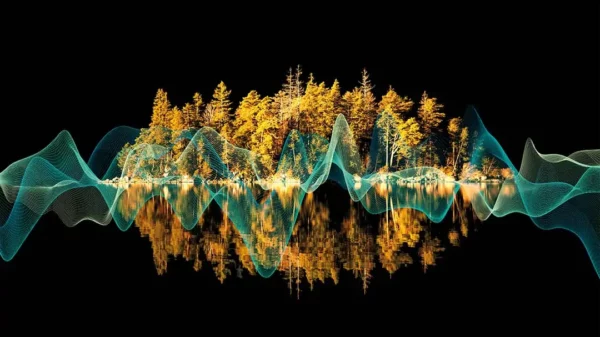












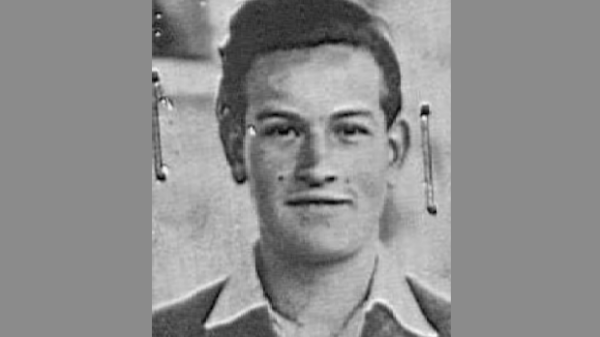

















Derniers commentaires