
« Enfants de parents », camp du Barcarès @ 1011
L’artiste grenobloise 1011 ne cesse d’interroger le monde et ses pulsions. Jouant sur les symboles et leur détournement, philosophique et politique, son travail nous interroge sur la condition de la femme (Lapidation totale, Hommage à Malala, This Is Not Consent, Infibulation), sur l’écologie (Hommage à Magritte), la politique (Eva et les dictateurs, Héraclite, Le Nouvel Ordre mondial) et sur l’histoire (Enfants de parents). C’est d’ailleurs à propos de ces derniers, qui sont en réalité enfants de parents déportés, qu’elle a travaillé sur les camps d’internement des Juifs pendant la dernière guerre, dont celui de Vénissieux.

« Hommage à Malala » @ 1011
D’où vient votre nom, 1011, et comment d’ailleurs faut-il le prononcer : Mille Onze ou Dix-Onze ?
1011 : C’est Mille Onze. Le nom vient d’un duo. L’autre est un homme philosophe. Quand je l’ai rencontré, il avait choisi ce pseudo, qui est du langage binaire et qui signifie onze dans la numérotation décimale. Je l’ai épousé et je suis devenue moi aussi 1011. Tout ce qu’on cosigne porte ce code-barres familial, que ce soit de l’art, de la philosophie ou les deux mélangés. Il est toujours question de philosophie au sens large et de politique dans notre travail. De questions universelles. Après mon exposition Enfants de parents sur la Shoah, je me suis demandé s’il était judicieux de porter un nom qui était un chiffre et qui pouvait renvoyer aux tatouages des prisonniers. Un chiffre est anonyme et, finalement, ça me convenait.
Pourquoi vous êtes-vous intéressée aux camps d’internement français de la Seconde guerre mondiale ?
C’est une longue histoire qui remonte à mon enfance. Je suis Bretonne, élevée dans une famille chrétienne, ayant eu une enfance paisible. Dans les années soixante-dix, ce sujet tabou qu’était la Shoah a commencé à être évoqué. J’ai vu une expo qui m’a épouvantée, parce qu’elle n’était pas du tout faite pour les enfants. La rencontre avec un ancien déporté qui racontait ce qu’il avait vécu m’a donné l’impression d’être entrée dans l’âge adulte. La Shoah m’a ensuite suivie toute ma vie. J’ai beaucoup lu sur ce sujet. Ma première œuvre a été Lettre morte, sur une fillette juive, Marie Jelen, déportée avec sa mère au Vel’ d’Hiv’. J’ai travaillé à partir de sept lettres qu’elle avait envoyées à son père, parti travailler dans les Ardennes, à partir du camp de Pithiviers. Sur sept photographies (NDA : provenant d’images réalisées clandestinement depuis l’intérieur d’une chambre à gaz de Birkenau par un prisonnier juif des Sonderkommandos), j’ai brodé les sept courriers, ton sur ton. Quand la photo était noire, j’utilisais du fil noir, quand elle était blanche, du fil blanc. Ce fut ma première entrée sur le sujet.
Quelles furent les réactions ?
À la fois très positives et très négatives. Je travaille dans la médiation au musée de Grenoble et j’aime en faire autour de mon travail. À Chambéry, une dame furieuse est venue vers moi en me demandant pourquoi j’avais fait cela. Je lui ai répondu que c’était un sujet qui me hantait depuis mon enfance. Oui, mais de quel droit je l’avais fait ? Bien que non-juive, c’était comme si ma famille avait vécu cela, ma famille humaine, l’humanité. Elle-même portait un tatouage. Toute sa vie, elle n’en avait jamais parlé à quiconque. À partir d’un certain moment, elle avait dû se souvenir de tout cela pour continuer à vivre. À soixante ans passés, elle s’était mise à peindre sur ce sujet. Au final, on était toutes les deux émues. D’autres personnes m’ont beaucoup soutenue, estimant que chacun avait le droit de parler de la Shoah. Mais on se pose toujours la question. J’ai souvent traité de sujets intolérables, comme l’infibulation ou la lapidation. L’ignorance du public est telle que tous les moyens sont bons pour aborder les sujets qui fâchent. Passer par l’émotion est parfois plus fort qu’un cours d’histoire, même si ce n’est pas suffisant.
Cette première expérience vous a donné envie de poursuivre dans cette voie ?
J’ai fait des recherches sur les enfants enfermés à Beaune-la-Rolande et à Pithiviers. Les autorités ne savaient pas quoi en faire puis Vichy a donné l’ordre de déportation. C’est ainsi que je suis entrée dans l’histoire des camps français, un sujet réellement tabou.

« Enfants de parents », camp des Milles @ 1011
Ce travail a-t-il été vu ?
Oui, Enfants de parents a été exposé à deux reprises. La première avec dix images, puis après avec cent. Quand on parle avec les gens des camps français et qu’on leur demande leur nombre, même les plus cultivés ne peuvent en citer que quelques-uns : Drancy, Les Milles, Gurs mais guère plus. Quand on leur apprend qu’il y en a eu plusieurs centaines, en comptant aussi les hôtels réquisitionnés, ils tombent des nues. C’est un sujet totalement méconnu. Aujourd’hui, la connaissance a progressé, plusieurs thèses ont été écrites.
Vous êtes-vous rendue sur place ?
J’en ai visité certains, transformés en lieux de mémoire, tels que la prison Montluc ou Les Milles. La plupart sont devenus des centres commerciaux ou des pavillons de banlieue. Il n’en reste souvent rien si ce n’est de petites plaques dans le meilleur des cas. À Grenoble, une plaque a été apposée en 2016.
Pourquoi ce choix des poupées ?
Je voulais un objet qui symbolise l’enfance car je me fais un point d’honneur à montrer toujours des images esthétiques et pas trash. Les poupées évoquent les enfants déportés mais ne les montre pas. Même si le sujet était leur déportation, je ne voulais pas les montrer. Il existe une photo célèbre d’une petite fille à Drancy, endormie avec une poupée dans les bras. La poupée était un beau symbole et je voulais au départ qu’elles viennent de musées de la déportation. Mais ils n’en ont quasiment aucune. Je me suis attelée à faire le tour des brocantes pour trouver des poupées fabriquées avant 1945.

« Enfants de parents », camp de Vénissieux @ 1011
Ébréchées, cassées, avec ces quelques mots en-dessous qui portent le nom d’un camp, elles prennent une toute autre signification qu’une simple poupée…
Elles deviennent le symbole de l’enfance meurtrie. Pour les noms des camps, que j’ai brodés au-dessous, je ne voulais pas que ce soit mon écriture mais, qu’au contraire, nous ayons un lien direct avec l’Histoire. J’ai donc cherché des courriers échangés à partir des camps. J’en ai retrouvé plus d’une centaine, grâce aux philatélistes spécialisés dans ce domaine. J’ai agrandi les adresses des expéditeurs. Quelqu’un avait vraiment écrit ces mots. Il y avait derrière eux l’histoire d’une vie. C’est pourquoi chaque écriture est différente. Pour celui de Vénissieux, je suis tombée sur une lettre sur laquelle était inscrite « camp des Indochinois, Vénissieux ».
Quelques réactions à votre travail ?
Serge Klarsfeld m’a écrit « Cette exposition Enfants de parents est impressionnante » et Yad Vashem, l’institut international pour la mémoire de la Shoah, m’a répertoriée comme artiste travaillant sur ce sujet.
Dans une interview, vous citez le nom du plasticien Kader Attia qui, lui aussi, détourne les images. Peut-on aussi parler de « réparation » à propos de votre travail, comme il le fait à propos du sien ?
Non, ce n’est pas pareil. Je suis affolée que les gens oublient ce qui s’est passé. Je fais plutôt œuvre de mémoire. C’est pour cette raison que j’estime important le travail de médiation fait pendant les expos, pour que ce ne soit pas juste des images vues et oubliées.

« Le Nouvel Ordre mondial » @ 1011
Je sais que vous avez créé une série baptisée Le Nouvel Ordre mondial, sur la pollution plastique des océans. Peut-on la voir ?
C’est un travail en cours qui n’est pas achevé. La crise a annulé tout ce qui était prévu. Je devais exposer à Montpellier à la mi-mai mais ça tombe à l’eau comme la plupart de mes projets. Je devais aussi être cet automne à Paris mais je ne sais pas si c’est maintenu.
https://1011-art.blogspot.com/

1011

















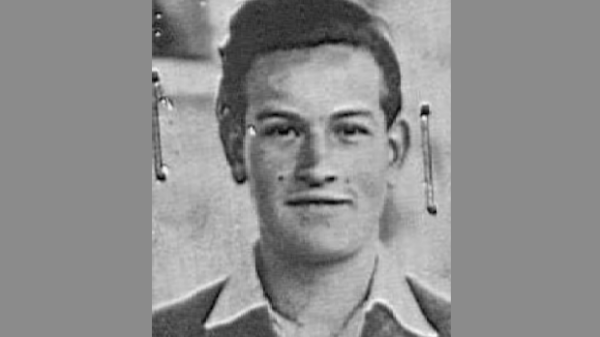






















1011
28 avril 2020 à 11 h 42 min
Merci pour votre article et la qualité de la mise en page, d’autant que les images des oeuvres en grand format est très plaisant . Les échanges, les discussions sont salutaires pendant le confinement.
Au plaisir d’une rencontre à Vénissieux !