
Partenaire fidèle des Assises internationales du roman, une manifestation organisée dans toute la Métropole par la Villa Gillet, la médiathèque Lucie-Aubrac recevait, ce 30 mai, la journaliste et romancière turque Ece Temelkuran. Une rencontre à laquelle assistait principalement une classe du lycée Jacques-Brel et qui attira malheureusement moins de monde que les années précédentes, comme celles par exemple avec Nancy Huston, Javier Cercas, Jorge Volpi ou Richard Russo.
Les élèves avaient lu « À quoi bon la révolution si je ne peux danser ? », le seul roman d’Ece Temelkuran publié à ce jour en français (chez Jean-Claude Lattès). Ils en donnèrent, en début de rencontre, une lecture qui ravit la romancière. « Très très… beautiful ! » s’exclama cette dernière en ayant pris soin d’enregistrer les élèves sur son téléphone portable.
« J’ai été journaliste pendant vingt ans, expliquait Ece, dont dix en écrivant des commentaires politiques pour un journal très sérieux. Je viens d’un pays qui est fou et où la réalité est plus absurde que la fiction, ce qui aide pour créer des histoires. Si j’écrivais comme une fiction ce qui se passe en une journée en Turquie, personne ne me croirait ! Je suis obligée de calmer la réalité pour la rendre crédible. »
Les élèves voulant savoir si le journalisme l’a aidée dans son écriture fictionnelle, l’écrivain répond : « Le journalisme est le laboratoire de la vie humaine le plus passionnant. On peut voir le pire et le meilleur de l’humanité. J’écris à présent pour des médias étrangers tels que The Guardian ou le New York Times mais plus pour les journaux turcs. »
La question « Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes en Turquie » lui fait choisir ses mots. « Déprimée » est celui pour lequel elle se décide finalement. Elle ajoute : « Quelques jeunes femmes m’inspirent beaucoup, qui luttent pour leur vie. » Et lorsqu’il faut faire la différence entre l’écriture d’articles ou de fictions, l’humour l’emporte : « Ces deux écritures, c’est comme si l’on parlait deux langues différentes. Quand on est furieux, on ne peut pas écrire un roman et, en général, je suis furieuse. Le roman a besoin d’un état d’âme tranquille et de sang froid. »
Sur son parcours, elle dit peu de choses : des études de droit à Ankara, « la ville la plus ennuyeuse du monde ». « Oui, je suis avocate aussi. Je n’ai pratiqué ce métier qu’une seule journée mais c’était pour des enfants kurdes de 12-13 ans. Par chance, ils ont été libérés ! »
Quant aux dangers qu’elle court dans son pays, là encore, elle ne désire pas trop en parler. « Je me suis sentie en danger mais, quand tout le monde l’est, c’est normal ! On se sent comme un enfant gâté si on parle trop du fait qu’on est menacé. »




















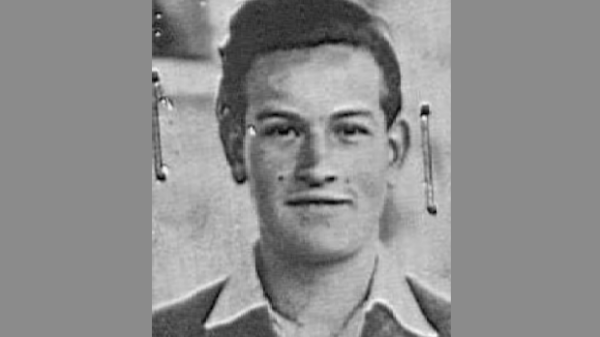





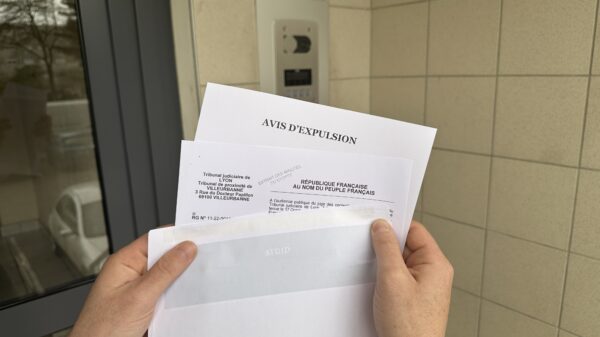











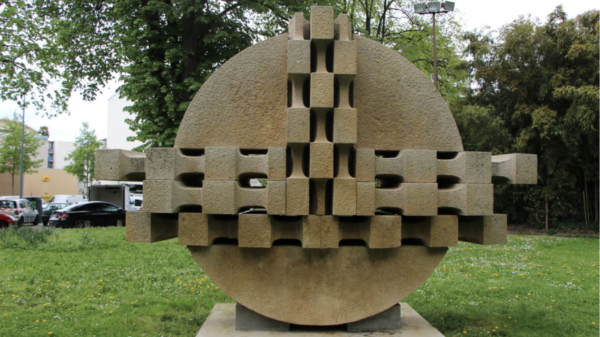

Derniers commentaires