

Maire de Vénissieux de 1904 à 1905, le philanthrope Laurent Gérin a marqué la ville de son empreinte
Il y a toujours eu des riches et des pauvres. Sous l’Ancien Régime, Vénissieux connaissait déjà les deux extrêmes de l’échelle sociale, avec un seigneur et une poignée de bourgeois lyonnais juchés à son sommet, et une foule de paysans modestes et de crève-la-faim massés tout en bas. La charité des personnes cousues d’or envers les moins fortunés corrigeait un peu ces injustices sociales ; donner était considéré comme un geste pieux et l’on ne s’en privait pas, surtout au moment de passer de vie à trépas : ainsi les plus nantis pensaient gagner une place en paradis. Jean Cornuti, un riche lyonnais, n’agit pas autrement lorsqu’il lègue en 1530 son grand domaine de Vénissieux aux pauvres de l’hôpital de Lyon. Ses biens, gérés par des religieux, serviront à soulager la détresse de ses contemporains. Le “domaine Cornuti”, et d’autres donations plus modestes, remplirent ce rôle durant des siècles, jusqu’à ce que la Révolution française s’en empare et les vende aux enchères, comme tous les biens du clergé. Un comble ! Les promoteurs de l’Égalité et de la Fraternité dépouillèrent d’un seul coup de loi tous les nécessiteux du pays ! L’Assemblée nationale se rendit compte de son erreur, et pour la réparer, créa en 1796 une institution vouée aux miséreux : les Bureaux de bienfaisance. Chaque commune de France était censée en créer un aussitôt que possible mais, dans les faits, les maires traînèrent les pieds, faute de moyens suffisants. À Villeurbanne par exemple, le Bureau de bienfaisance ne vit le jour qu’en 1846, avec 50 ans de retard sur la loi.
L’ancêtre du CCAS
À Vénissieux les choses allèrent beaucoup plus vite, puisque le conseil municipal créa le Bureau de bienfaisance dès le 16 mars 1816, il y a maintenant 200 ans. Mûs par un grand élan du cœur, le curé de la paroisse, le maire Pierre Melin et plusieurs notables de la commune avaient décidé de prendre le taureau par les cornes pour soulager “la détresse de la classe indigente”. Leur initiative est immédiatement suivie par la population : dès 1817, les legs affluent au Bureau de bienfaisance, dont 1 000 francs de Christophe Chareyre et 200 francs de Marie-Thérèse Dereylieu. Désormais, peu d’années se passent sans qu’un Vénissian plus ou moins fortuné ne donne tout ou partie de ses biens au Bureau ; le record est atteint en 1906, lorsque l’ancien maire Laurent-Joseph Gérin lègue pas moins de 197 000 francs, une fortune ! Plus couramment, l’institution reçoit des ruisseaux de piécettes provenant de différentes recettes : les droits payés sur les concessions au cimetière, une taxe sur les spectacles, les aides de l’État, le produit des quêtes organisées une à deux fois l’an et lors des grandes fêtes, les dons d’associations sportives, d’industriels ou de simples particuliers, comme à l’occasion d’un mariage ou d’un banquet. Le Bureau de bienfaisance bénéficie ainsi de 3 000 à 4 000 francs de revenus dans les années 1860, 10 000 à 15 000 francs durant la Première guerre mondiale.
Ces sommes sont gérées par le conseil du Bureau, qui réunit une fois par mois six ou sept notables de Vénissieux : le maire et certains de ses adjoints, le curé, les plus riches paysans, et même des patrons d’usines, retors à verser de bons salaires à leurs ouvriers mais prompts à se montrer solidaires envers leurs concitoyens. C’est à ces hommes que revient la tâche, souvent lourde et contraignante, de répartir les secours aux plus nécessiteux. Au début de son existence, le Bureau de bienfaisance aide ceux que la vie a meurtris — les handicapés physiques, les vieillards, les anciens combattants des guerres napoléoniennes, ainsi que les chefs de famille surchargés d’enfants —ceux qu’on appelle “les prolétaires”. Puis son rôle s’accroît au fil du temps pour concerner aussi les malades, les femmes enceintes, les victimes de catastrophes, comme les inondations du Rhône en 1856, ou “les familles les plus éprouvées par l’orage du 21 juin” (1874), sans oublier les laissés pour compte de la conjoncture économique, dont ces “familles éprouvées par la crise industrielle, que le manque de travail prive temporairement de leurs moyens ordinaires d’existence”, en 1874. Durant la période hivernale, soit de décembre à mars, ces malheureux reçoivent des tickets qui leur permettent de retirer auprès des commerçants du pain pour se nourrir et du charbon pour se chauffer. Les malades, eux, bénéficient à partir de 1896 d’un service médical gratuit. Par contre, le vœu du tonnelier Antoine Billon de fonder une “école d’asile pour l’enfance en bas âge”, avec les biens qu’il légua en 1876, ne fut malheureusement pas réalisé.
L’accès aux secours ne se fait qu’après un examen sévère : si en 1903 Lacour obtient sans problème une admission au sanatorium d’Hauteville-Lompnes (Ain) car “ce malade, absolument dépourvu de ressources, père de trois enfants en bas âge, d’une moralité bien connue, est absolument digne d’intérêt” ; en 1918 Antoine-Émile Salino, pourtant amputé d’une jambe à la suite d’un accident de tramway, voit son cas rejeté au prétexte que “son infirmité ne lui impose pas d’incapacité de travail”. Refus aussi à Madame Gardon, en 1908, parce qu’elle “n’est âgée que de 66 ans, qu’elle n’est pas impotente et qu’elle vit avec son fils qui peut et doit pourvoir à tous ses besoins”. Pourtant, la comptabilité du Bureau montre qu’il aurait eu les moyens d’aider ces personnes, puisque son bilan annuel se solde systématiquement par un bénéfice, souvent confortable. Mais l’institution préfère investir le quart ou le tiers de ses recettes — et même les deux tiers en 1916 — dans des bons du Trésor public pour se constituer une rente, plutôt que de vider ses caisses ! Malgré ce réflexe d’épargnant près de ses sous, le nombre de bénéficiaires de la solidarité communale devient de plus en plus important. En 1847, le Bureau aide ainsi 35 personnes. Vingt ans plus tard, en 1866, il en secourt 49 : un aveugle, un paralytique, 4 infirmes, 16 vieillards et 27 chefs de famille chargés d’enfants. En 1898, le nombre de bénéficiaires atteint 118. Arrive la Première guerre mondiale, qui voit le Bureau de bienfaisance se démener comme jamais auparavant. Le dénuement dans lequel la mobilisation a plongé tout un pan de la population l’amène à fournir des dizaines de tonnes de pain et de charbon, que les membres du bureau commandent directement aux mines, tout en accordant en urgence l’aide médicale à des centaines de personnes ; 125, sur la seule liste du 5 décembre 1918. Et ainsi de suite, jusqu’aux portes de notre temps : les Bureaux de bienfaisance ont été transformés le 29 novembre 1953 en Bureaux d’aide sociale, ancêtres directs du Centre communal d’action sociale (CCAS). Sous ce nom, l’organisme municipal poursuit l’œuvre maintenant bicentenaire du mouvement solidaire instauré à Vénissieux en 1816.
Sources : Archives de Vénissieux, registres des délibérations municipales (1816-1858), et cote 1 Q 246 (archives du Bureau de bienfaisance, 1841-1953).


















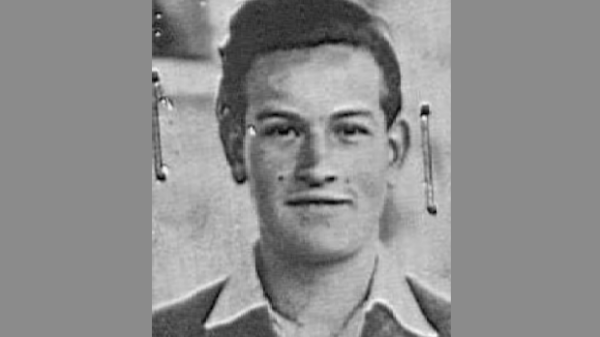


















Viniciacum
20 mars 2016 à 16 h 53 min
Bonjour,
Quand vous dites « le vœu du tonnelier Antoine Billon de fonder une école d’asile, avec les biens qu’il légua ne fut pas réalisé », je ne sais pas d’où vous tirez cette information, un document le mentionnait sans doute, mais nombre de Vénissians ont fréquenté l’asile Billon qui, à notre grand regret, a été démoli en février 2014, voir Expressions n°552 à ce sujet où le site de notre association http://viniciacum.fr/ecole_billon.html
Cordialement
C.Barioz, président de l’association d’histoire et de sauvegarde du patrimoine de Vénissieux, Viniciacum